Le manga : histoire, accueil et évolution d’une fiction japonaise… avec Bounthavy Suvilay
Alors que le manga enchaîne les records de vente sur le marché français cette année, il gagne aussi ses lettres de noblesse auprès d’un public de plus en plus large : les titres de la première heure deviennent petit à petit des classiques, des institutionnels prennent le manga comme une référence culturelle… Aux côtés des éditeurs et des médias, des écrivains, essayistes et universitaires se penchent de plus en plus souvent sur la BD japonaise, et proposent pour la plupart des ouvrages passionnants, aussi bien pour les fans que pour les néophytes. C’est justement entre ces deux publics que nous avons rencontré Bounthavy Suvilay, agrégée en lettres modernes et docteur en littérature, à qui l’on doit cette année deux ouvrages : Dragon Ball, une histoire française et Culture Manga, Origines et influences de la bande dessinée japonaise.
Deux livres aussi riches que différents, l’un issu d’une thèse sur Dragon Ball et son impact à tous les niveaux et l’autre, une présentation complète mais rapide, façon que-sais-je, sur cette culture qui nous passionne. En commun : un intérêt communicatif pour le manga, ses recettes et son histoire, son modèle économique, son impact au Japon et en France, ou encore l’évolution remarquable de la perception de cette BD nippone en dehors de ces frontières sur ces 30 dernières années.
Autant de sujets passionnants, cela valait bien une interview !
Bounthavy Suvilay : de Racine à Toriyama, une culture sans préjugé.
Journal du Japon : Bonjour Bounthavy et merci pour votre temps. Commençons par parler (un peu) de vous. Dans votre biographie, on lit que vous êtes agrégée en lettres modernes et docteur en littérature, et que votre thèse portait sur Dragon Ball (Réceptions et récréations de Dragon Ball en France : manga, anime, jeux vidéo. Pour une histoire matérielle de la fiction (1988-2018)). Vous avez aussi écrit plusieurs ouvrages dans le domaine du jeu vidéo… Première question : vous rêviez de faire quoi quand vous étiez petite ?
En fait, je n’avais pas vraiment de métier rêvé. Je rêvais surtout d’être fabricante de Lego et pouvoir faire des trucs avec les briques. Mais « ingénieur Lego » ça n’existe pas selon les conseillers d’orientation… Du coup, j’ai fait des études, pas mal de détours et je suis arrivée par hasard là où je suis. J’ai un pied dans le secteur public en tant qu’enseignante et un autre dans le secteur privé en tant que rédactrice. J’ai publié des articles dans des revues universitaires mais j’ai aussi été rédactrice en chef pour différents magazines de jeux vidéo (IG Magazine, Dofus Mag) et écrit le premier livre consacré aux studios de jeux vidéo indépendants en France. Je ne sais pas où je vais et je fais juste au mieux pour que ma petite barque évite de se retourner dans les rapides.
Bien sûr, j’ai bien conscience que je devrais mieux me vendre en disant que j’avais la vocation depuis mon plus jeune âge et que tout suit une route bien tracée par ma passion. Mais je suis simplement honnête.
De quand date et comment s’est déroulée votre rencontre avec le manga, les animes, les jeux vidéo ?
Je suis de la génération Club Dorothée et j’ai découvert les anime à la télévision à une époque où il n’y avait que trois chaînes et où internet n’existait pas. J’ai vu Akira dans une salle de cinéma d’art et d’essai parisien à l’époque où mes camarades de classe pensaient que le dessin animé japonais était un truc de merde. J’étais à la fois avec les ostracisés au fond de la classe qui ont des goûts douteux et parmi les bons élèves au niveau des résultats scolaires.
Pour moi, il n’y avait pas de différence entre les Feux de l’amour et les tragédies de Racine : il s’agit à chaque fois d’histoires de famille et de relations de couple qui se finissent mal. Seule la façon de raconter l’histoire diffère. Du coup, j’ai toujours lu et vu beaucoup de récits quel que soit le prestige culturel attaché aux récits en question.
J’ai découvert le jeu vidéo en faisant du baby-sitting car mes parents ouvriers n’avaient pas les moyens de me payer une console. Du coup, je jouais avec les gamins que je gardais et j’ai pu découvrir Zelda comme une aventure collective où l’un tenait la manette et les deux autres débattaient de ce qu’il fallait faire pour progresser dans le donjon. Je n’ai eu de console que tardivement et j’ai surtout beaucoup joué avec les consoles des autres. J’ai aussi une relation un peu obsessionnelle avec certains titres que je refais régulièrement.
Nous allons par la suite aborder vos travaux mais à titre personnel, quelle lectrice de manga êtes-vous ? Quels sont vos auteurs et/ou titres phares ?
J’ai des goûts assez conventionnels. J’aime les récits plutôt destinés à un public masculin comme Fullmetal Alchemist, L’Attaque des titans, Haikyû ! Je recherche le côté épique et une certaine sincérité dans la description de l’héroïsme. Dans un monde où tout le monde pense être pointu en étant ironique ou second degré, je trouve que l’obstination d’un héros au service d’une cause qui le dépasse est un sujet admirable.
Mais j’ai aussi été très marquée par des récits destinés aux filles, dont les versions animées de La Rose de Versailles (Lady Oscar) et Fruits Basket. J’adore certaines séries conçues initialement pour l’anime comme Neon Genesis Evangelion (série et films récents) et Kill la Kill car les réalisateurs ont vraiment réussi à exploiter le support animé en faisant référence à des filiations historiques et en inventant de nouvelles formes de mises en scène. Je suis fan du style graphique de Takehiko Inoue, Mitsuru Adachi, Akira Toriyama et Akihiro Yamada, même si leurs récits ne sont pas toujours géniaux. Au niveau de l’animation, je trouve que Satoshi Kon est le vrai génie du cinéma japonais et que les réalisateurs aujourd’hui célébrés par la presse grand public n’ont pas tant d’intérêt que cela même si leurs films sont très divertissants.
Vous avez fait des études littéraires mais comment le manga est passé d’objet de lecteur à objet d’étude… A moins que vous n’ayez jamais fait cette distinction ?
Le but des études littéraires est avant tout d’analyser les récits et les styles que ce soit une pièce de théâtre, une poésie, un roman. La base du manga moderne, c’est le feuilleton, un récit qui se prolonge à l’infini tant qu’il y a des gens pour le lire. Ensuite, le style graphique, la manière de mettre en case et en page, c’est ce qui distingue un auteur d’un autre. Il n’y a donc pas vraiment de distinction entre la littérature et le manga, si ce n’est que la bande dessinée ajoute un élément graphique à l’art du récit. Chaque époque proposant des supports différents, il est intéressant d’analyser les œuvres disponibles avec des formats contemporains car les créateurs ne sont pas limités par les frontières arbitraires des administratifs créant les programmes scolaires ou les catalogues des musées. Si Racine était vivant aujourd’hui, il ferait sans doute des séries pour Netflix.
Bien sûr, je ne dis pas qu’il faut arrêter d’étudier les tragédies classiques. Bien au contraire, il s’agit d’étudier la Littérature française et de transmettre ses plus belles œuvres tout en intégrant des éléments contemporains, en montrant que ceux-ci partagent certaines valeurs ou du moins permettent de comprendre leur évolution dans le temps.
En parlant d’objet d’étude… Faire une thèse sur Dragon Ball : comment est née l’idée et pouvez-vous nous décrypter le titre assez riche de votre thèse ?
La thèse avait pour but de combiner plusieurs compétences personnelles et j’ai choisi un objet qui combine à la fois le manga, l’animation, le jeu vidéo et les produits dérivés tout en ayant un vrai intérêt historique.
Dragon Ball est le véritable déclencheur de l’engouement du manga en France. Ce n’est pas Akira, qui à l’époque était un échec commercial. L’immense succès de Dragon Ball en manga a incité tous les autres éditeurs à se lancer dans la traduction de séries japonaises alors que dans les années 1980 les différentes tentatives de populariser la bande dessinée japonaise s’étaient soldées par des échecs. D’autre part, Dragon Ball a une valeur historique dans le sens où les différentes adaptations de la série permettent de montrer l’évolution des perceptions du manga et de l’anime par le grand public en France. Mais elles témoignent aussi des changements économiques au niveau des méthodes de production au Japon.
Du coup, le titre à rallonge de ma thèse vise à souligner cette perspective historique portant à la fois sur la production et la réception de Dragon Ball. Je m’intéresse d’une part à l’écosystème médiatique dans lequel nait et se développe Dragon Ball, ses adaptations et ses dérivés ; d’autre part, je montre les différentes manières dont les éditeurs et diffuseurs français ont traduit et modifié Dragon Ball en fonction de l’idée qu’ils se faisaient du public de leur temps.
Il ne s’agit pas d’un jugement de valeur sur la qualité des traductions mais de montrer pourquoi les traducteurs, les doubleurs et les diffuseurs ont jugé pertinent de modifier les épisodes d’anime dans les années 1990 d’une certaine manière et pourquoi ces mêmes professions ont choisi de faire autrement dans les années 2000.
Aujourd’hui, on peut rire ou s’offusquer du fait que les dialogues de Nicky Larson et Ken le survivant ont été totalement modifiés. Mais à l’époque, les gens qui ont altérés les œuvres originales l’ont fait en pensant protéger les enfants de la violence des séries japonaises. D’une façon générale, les pires atrocités sont toujours accomplies sous prétexte qu’elles servent leur bien d’autrui. Par la suite, une nouvelle génération de professionnel a choisi de corriger ce qu’ils considéraient comme les erreurs du passé. Mais leur hypercorrection est parfois allée trop loin et une nouvelle cohorte adopte d’autres approches.
Du coup, ma thèse sert avant tout à montrer tout le processus d’acclimatation en France d’une œuvre étrangère initialement destinée uniquement au public japonais. Dragon Ball sert de fil rouge mais la description historique s’applique à d’autres œuvres de ce type.
Dans le monde universitaire est-ce que faire une thèse sur le manga (ou sur UN manga comme Dragon Ball) est devenu courant ? Comment ce sujet, et plus généralement le média manga, était vu par vos pairs et vos enseignants ?
Il y avait déjà eu des thèses sur des mangas ou des jeux vidéo dans des universités à l’étranger dans diverses disciplines. Mais ma thèse est l’une des premières à proposer une étude intensive d’une œuvre sur plusieurs médiums.
L’originalité de ma thèse réside dans le fait qu’elle vise à étudier la production et la réception d’une fiction et non pas d’un manga ou d’un jeu vidéo seul. Autrement dit, mon hypothèse de travail est que l’on ne peut pas comprendre Dragon Ball si l’on se contente de l’étude d’un support quand bien même il s’agit de l’œuvre originale.
Pour moi, les fictions contemporaines sont avant tout des œuvres transmédiatiques, c’est-à-dire des univers qui ont plusieurs portes d’entrée et se développent sur plusieurs formats en parallèle (imprimé, audiovisuel, jeu vidéo, produits dérivés, etc.). Autrement dit, pour le public qui a découvert Dragon Ball avec les jeux PlayStation, l’œuvre d’Akira Toriyama n’a que peu d’importance et certains ne la liront même jamais. Mais grâce à ces adaptations, Dragon Ball, ses personnages et ses récits se transmettent à travers plusieurs générations.
Pour la thèse, j’ai eu la chance de travailler avec Marie-Ève Thérenty et Matthieu Letourneux qui partagent une approche maximaliste de la littérature, englobant des nouveaux supports contemporains. Mais cette façon d’envisager la communication littéraire n’est pas encore généralisée dans l’université française. Du coup, je suis souvent considérée comme trop littéraire pour les gens de la section « sciences de l’information et de la communication », trop « littérature comparée » pour ceux qui travaillent en littérature française, etc.
Je pense qu’il faut arrêter de s’enfermer dans des frontières administratives où les gens qui étudient le cinéma ne s’adressent jamais à ceux qui analysent le jeu vidéo et ceux qui s’intéressent à la construction des récits. Fermer un œil pour mieux viser est utile, mais devenir borgne ne devrait pas devenir un idéal. En conservant cet œil fermé, on perd la richesse du réel.
Dragon Ball, d’une génération à l’autre
 Pour nos lecteurs que cette thèse interpellera déjà, quel est le lien entre cette dernière et votre ouvrage Dragon Ball, une histoire française édité cette année aux Presses Universitaires ?
Pour nos lecteurs que cette thèse interpellera déjà, quel est le lien entre cette dernière et votre ouvrage Dragon Ball, une histoire française édité cette année aux Presses Universitaires ?
L’ouvrage est une version très condensée de la thèse qui montre l’évolution des versions françaises de Dragon Ball tout en les replaçant dans un contexte social et économique. Il ne fait que 380 pages, comprend peu de notes de bas de page et comporte une bibliographie réduite.
Comment expliquez-vous la si grande longévité de cette série, au Japon comme en France ?
Il y a plusieurs raisons liées à l’évolution du marché du divertissement et aux décalages des réceptions. Lorsque Dragon Ball est à son apogée, le Japon achevait son expansion pour devenir la deuxième puissance économique mondiale. La fin de Dragon Ball en 1995 correspond au début d’une interminable stagnation économique et d’une chute des ventes du Shônen Jump qui ne s’en est jamais remis. Plus encore, 1995 est marqué par deux événements traumatiques : le tremblement de terre de Kobe et les attentats au gaz sarin. La fin de Dragon Ball correspond ainsi à la fin d’une époque, ce qui ne fait que renforcer l’attrait du manga original auprès du jeune public qui a suivi les aventures de Son Goku durant près de dix ans.
Pendant que le Japon passait à autre chose et que le jeu vidéo prenait plus d’importance que le manga et les anime, en Europe et aux États-Unis le jeune public a découvert avec retard les séries télévisées japonaises. Les éditeurs se sont mis à leur proposer des produits dérivés. Mais s’il est facile de traduire des mangas, il est quasiment impossible de vendre de vieux jeux traduits destinés à une console rendue obsolète par la sortie des machines de nouvelles générations. Les éditeurs occidentaux ont alors réalisé des adaptations vidéoludiques inédites pour leur public. Celles-ci ont ensuite été vendues au Japon ce qui a permis à des gens qui n’ont pas connu Dragon Ball à travers Shônen Jump d’entrer dans l’univers par le biais des jeux vidéo dans les années 2000. Le retard de diffusion et les contraintes du marché du jeu vidéo ont ainsi permis à Dragon Ball d’exister de manière presque ininterrompue.
Voyant le succès de Dragon Ball en jeu, Toei a fait revivre la série à travers Dragon Ball Z Kai à partir de 2009 ce qui a permis de lier l’ancienne génération de lecteurs à un public plus jeune qui découvre l’univers de Son Goku à travers cette version réduite du deuxième anime. Dans le même temps, les cartes à collectionner en jeu vidéo Dragon Ball Heroes ont trouvé un succès similaire à celui des cardass des années 1990.
Ainsi, la longévité de Dragon Ball est entretenue par la multiplicité des médiums où l’univers s’étend et de nouveaux récits s’inventent. Le monde de Son Goku est toujours présent sur le dernier support en vogue que ce soit internet à travers des mèmes réalisés par des fans puis réexploités en produits dérivés par les ayants droit ou des jeux mobiles free to play. Le succès d’une fiction se manifeste donc à travers le nombre de ses adaptations et la diversité des supports.
Détail amusant mais vous évoquez le cas de Goldorak dans votre ouvrage sur Dragon Ball, alors que ce dernier fait cette année un revival avec plusieurs actualités autour de la licence. L’impact de Goldorak a son arrivée en France n’était pas anodin mais par contre la série, elle, est tombée plusieurs fois dans un certain oubli…Comment expliquer que Dragon Ball, en somme, ne nous ai jamais quitté alors que Goldorak est plutôt à ranger dans la case nostalgie (même si on souhaite toute la réussite possible à l’adaptation à venir, évidemment) ?
Je pourrais aussi compléter la comparaison avec Saint Seiya qui, pour le coup, a lui aussi eu le droit à de nombreuses déclinaisons dans le temps et un manga fleuve mais qui, il me semble n’a pas une longévité ni une aura comparable à DB, du moins du point de vue de notre hexagone…
 Dans le cas de Goldorak, les éditeurs français n’ont pas pu entretenir l’intérêt du public par les adaptations. D’autre part, l’anime est un dérivé d’une série non diffusée en France, ce qui explique le peu de produits dérivés à importer. Ensuite, il faut ajouter les problèmes juridiques entre Go Nagai et Toei, puis Go Nagai et les diverses entreprises françaises qui ont exploité son œuvre. Cela ne contribue pas à favoriser les nouvelles adaptations. Certes, dans les années 1980, il y a eu des romans jeunesse écrits par des auteurs français, des bandes dessinées produites en Europe, et pas mal de disques 45 tours. Mais la qualité globale était médiocre alors que dans le cas de Dragon Ball, l’œuvre originale d’Akira Toriyama est un chef d’œuvre provoquant une immense claque graphique à son époque.
Dans le cas de Goldorak, les éditeurs français n’ont pas pu entretenir l’intérêt du public par les adaptations. D’autre part, l’anime est un dérivé d’une série non diffusée en France, ce qui explique le peu de produits dérivés à importer. Ensuite, il faut ajouter les problèmes juridiques entre Go Nagai et Toei, puis Go Nagai et les diverses entreprises françaises qui ont exploité son œuvre. Cela ne contribue pas à favoriser les nouvelles adaptations. Certes, dans les années 1980, il y a eu des romans jeunesse écrits par des auteurs français, des bandes dessinées produites en Europe, et pas mal de disques 45 tours. Mais la qualité globale était médiocre alors que dans le cas de Dragon Ball, l’œuvre originale d’Akira Toriyama est un chef d’œuvre provoquant une immense claque graphique à son époque.
Dans le cas de Saint Seiya, l’auteur et les ayants droit ont surtout misé sur la vente de figurines à collectionner, loisir relativement coûteux et assez peu connu en France dans les années 1990. Les adaptations en jeu vidéo n’étaient pas géniales et se sont peu vendues en comparaison à celles de Dragon Ball.
De plus, dans les deux cas, il n’y a pas eu de succès de diffusion aux États-Unis. Goldorak et Saint Seiya y sont totalement inconnus ce qui expliquent qu’il n’y a pas eu l’effet de décalage du succès commercial comme pour Dragon Ball. Même si la France est un grand pays consommateur de manga, sa population totale reste moindre que celle du Japon et dérisoire par rapport à celle des États-Unis. D’un point de vue économique, il n’y avait donc pas beaucoup d’intérêt de créer des jeux vidéo destinés au public français ou européen. Et lorsqu’il n’y a pas de nouvelles adaptations sur des supports contemporains, une série tend à errer dans les limbes.
En parlant de la réception en France, et désolé d’avance pour la question-pavé : Dans Dragon Ball, une histoire française tout comme dans la Culture Manga, Origines et influences de la bande dessinée japonaise on retrouve une étude commune de l’impact du manga à son arrivée en France puis de l’évolution de son image, de la perception du grand public comme de la presse ou des élites… On dirait – vous m’excuserez le raccourci j’espère – que le manga Dragon Ball est un peu un immigré culturel qui, en l’espace de deux-trois générations a parfaitement réussi son intégration… Comment a-t-il réussi ce tour de force ?
Son Goku et ses compagnons sont effectivement des immigrés bien intégrés en France même s’ils ne sont pas reconnus par les élites. Il faut dire que les personnages incarnent des modèles exemplaires promouvant une éthique du dépassement de soi, même si la série ne manque pas d’humour et de dérision (nom en référence aux sous-vêtements, danse débile pour fusionner, etc.). Le public grandit avec Goku, qui débute comme un enfant naïf et finit père de famille (toujours un peu niais) mené à la baguette par sa femme lorsqu’il est à la maison. En un sens, Dragon Ball propose de vivre un rite d’initiation par procuration à travers un personnage de fiction. Les héros évoquent un idéal de virilité commun à beaucoup de civilisation ce qui facilite leur intégration.
D’autre part, les personnages créés par Akira Toriyama sont extrêmement bien intégrés dans tous les pays où ils sont présents grâce à la télévision, media de masse qui était hégémonique avant la démocratisation du haut débit. En Espagne, j’ai rencontré des trentenaires capables de me réciter des dialogues de l’anime par cœur et qui ont pris des jours de congé lors de la sortie de Dragon Ball Fighter Z ! Pour eux, Son Goku est catalan (lorsqu’ils sont Barcelonais) ou galicien (lorsqu’ils habitent près de Saint-Jacques-de-Compostelle) car la série était diffusée sur les chaînes régionales dans les langues locales (contrairement aux séries diffusées sur les chaînes nationales en castillan). Cette intégration se perçoit notamment à travers les mèmes basés sur Dragon Ball mais qui restent propres à chaque pays (et donc peu compréhensibles pour ceux d’autres régions). C’est le cas du mème « It’s Over 9000! » utilisé aux États-Unis.
Dans le cadre de ma thèse, j’évoque rapidement les réceptions de Dragon Ball dans d’autre pays mais je me suis avant tout focalisé sur les transformations en France sur la période 1988-2018, car il fallait délimiter l’objet de la recherche.
La popularité de Dragon Ball a aidé les publics locaux à comprendre la mise en page du manga et a apprécié ce format de bande dessinée. Cela a favorisé la traduction d’autres séries du Shônen Jump partageant les mêmes valeurs viriles. Puis les éditeurs locaux se sont mis à traduire d’autres séries destinées à d’autres types de public (femme, adulte, jeunes enfants).
Pour le reste du processus et les détails, il faudrait lire les livres que j’ai écrit sur le sujet. Mais en caricaturant, Dragon Ball est au manga ce que Pokémon est à Nintendo : une killer app qui popularise un support.
Le manga : âge d’or et décadence
En France, il y a eu l’explosion du manga mais aussi des périodes creuses, puis un nouvel essor depuis 2014-2015… On pourrait penser à des cycles corrélés à l’avènement puis à la fin de séries phénomènes mais est-ce que l’explosion des ventes depuis 2 ans, qui fait même parler d’un nouvel âge d’or du manga en France, peut s’expliquer ainsi ?
 Il y a bien sûr des corrélations entre les séries à succès et les ventes sur le territoire français. Que ce soit L’Attaque des titans ou My Hero Academia, les séries fortes ne manquent pas même si l’âge d’or du manga semble passée.
Il y a bien sûr des corrélations entre les séries à succès et les ventes sur le territoire français. Que ce soit L’Attaque des titans ou My Hero Academia, les séries fortes ne manquent pas même si l’âge d’or du manga semble passée.
Mais d’autres phénomènes sont également à prendre en compte. Parmi eux, il y a des éléments liés à l’intervention de l’État comme le pass culture, dispositif spécifique à la France, qui a sans doute plus contribué au succès commercial des mangas que d’autres éléments récents. On peut y ajouter l’intégration récente du manga dans les recommandations de l’Éducation Nationale. En devenant une pratique culturelle assimilée à la lecture, le manga est mieux perçu par les élites.
En dehors des institutions, il y a les stratégies des grands groupes médiatiques en France et dans le monde. Le fait que tous les services de vidéo à la demande se battent pour proposer du contenu exclusif a permis de financer la création d’anime et faciliter la diffusion des séries japonaises. Ces adaptations offrent une couverture médiatique inégalée aux mangas. Ainsi Alice in Borderland a pu bénéficier d’un regain d’intérêt lors de la diffusion de la série télévisée en 2020.
Enfin, il faut prendre en compte le fait que les ayants droit japonais sont de plus en plus dépendant de l’exportation car le marché intérieur continue de diminuer. Certes, ils prennent des décisions qui peuvent sembler un peu déconnectées des réalités hexagonales mais ils investissent plus d’attention aux divers marchés non-japonais.
Bref, tout cela pour dire qu’il sera sans doute plus facile d’expliquer le rebond du manga dans quelques années lorsque toutes les données pourront être analysées en profondeur au lieu de proposer des hypothèses comme je viens de le faire.
Pour autant, même si une BD sur deux vendue en France est un manga, qu’en est-il de sa perception par d’une part, le grand public, et d’autre part, la presse… et enfin les élites ?
Je ne sais pas vraiment quoi répondre. J’ai l’impression que la question sous-entend qu’il serait bon que le manga soit reconnu au même titre que des poèmes de Victor Hugo. C’est le même genre de question que se posent les amateurs de jeu vidéo par rapport à la reconnaissance institutionnelle : pourquoi n’y a-t-il pas plus de place pour les consoles dans les musées alors que le jeu est la première industrie culturelle ?
Je comprends parfaitement que chacun ait envie que ses goûts soient partagés, voire célébrés comme les « bons » goûts. Se dire que la presse ou les élites apprécient le manga (ou le jeu vidéo) revient à confirmer la valeur de ses pratiques culturelles personnelles. La question est liée au statut social, non à la valeur créative. C’est une question qui ne m’intéresse pas vraiment car j’étudie avant tout les processus de production.
 Toutefois, j’ai l’impression que la stratification de la culture semble toujours suivre un même cycle. Au début, les outsiders, les misfits investissent un support et le rendent populaire auprès d’un public ultra niche. Shônen Jump a recruté tous les auteurs qui n’étaient pas déjà publié ailleurs et s’est retrouvé avec les génies comme Go Nagai qui a fait scandale avec L’École impudique. De même Capcom et les autres studios de jeux vidéo ont commencé par recruter les gens qui n’entraient pas vraiment dans les cases, car ils étaient les seuls à vouloir s’investir dans un domaine inédit où il n’y a pas de reconnaissance sociale. C’est dans cette phase qu’il y a toutes les innovations techniques, les créations de genre, les récits les plus fous qui vont marquer les générations à venir.
Toutefois, j’ai l’impression que la stratification de la culture semble toujours suivre un même cycle. Au début, les outsiders, les misfits investissent un support et le rendent populaire auprès d’un public ultra niche. Shônen Jump a recruté tous les auteurs qui n’étaient pas déjà publié ailleurs et s’est retrouvé avec les génies comme Go Nagai qui a fait scandale avec L’École impudique. De même Capcom et les autres studios de jeux vidéo ont commencé par recruter les gens qui n’entraient pas vraiment dans les cases, car ils étaient les seuls à vouloir s’investir dans un domaine inédit où il n’y a pas de reconnaissance sociale. C’est dans cette phase qu’il y a toutes les innovations techniques, les créations de genre, les récits les plus fous qui vont marquer les générations à venir.
Avec le succès commercial et l’afflux du grand public vient le désir de reconnaissance sociale. Les écoles spécialisées se créent, les enfants des élites se précipitent vers ses potentielles nouvelles carrières assurant un statut social enviable. De nouvelles pratiques de création et de consommation se forgent alors pour ces nouveaux venus qui veulent un loisir doté d’un prestige social. De fait, la créativité s’est éteinte et les institutions, les médias et les élites peuvent revêtir les oripeaux du cadavre qu’ils ont dépecé.
Pour un exemple plus prestigieux prenons le théâtre élisabéthain. Il n’y avait pas de texte figé à réciter par cœur car les manuscrits servaient avant tout d’aide-mémoire pour la performance sur scène. Le spectacle attirait un public hétérogène qui mangeait et s’engueulait pendant que les comédiens considérés comme des parias et les comédiennes comme des prostituées s’ingéniaient à retenir leur attention. Aujourd’hui, personne n’oserait manger du popcorn en commentant la prestance des acteurs de la respectable Comédie Française. Le théâtre est un loisir prestigieux mais ce sont toujours les mêmes pièces que l’on joue et le public n’est plus le même.
Dans le cas du manga, les misfits agonisent encore mais je ne sais pas pour combien de temps.
Sur les deux dernières décennies, comment expliquer la différence de succès, selon-vous, avec le comics, qui est très loin d’avoir fait le même chemin ou d’avoir atteint les mêmes performances commerciales malgré une décennie Avengers & co au cinéma ?
Je vais être très schématique mais je pense que le manga et le comics ont deux approches opposées. Les Américains veulent vendre la même chose à tout le monde alors que les Japonais pensent avant tout à vendre aux Japonais et laissent souvent les industries locales importer et adapter leurs fictions si elles le veulent.
Du coup, les Américains tendent à faire des versions aseptisées qui correspondent au plus petit dénominateur commun, qui sont censées ne déplaire à personne, qui promeuvent les idéologies à la mode. En voulant être universel, ils font des œuvres creuses qui stimulent les rétines ne mais parlent pas aux âmes.
Au contraire, les auteurs japonais s’adressent avant tout aux lecteurs locaux, qu’ils connaissent mieux et avec qui ils partagent les mêmes références culturelles et les mêmes inquiétudes. En étant typiquement japonais, ils parviennent à faire une œuvre universelle. Ils s’adressent à d’autres humains alors que les Américains s’adressent à des panels pré-selectionnés par le département marketing pour maximiser les réactions et les ventes.
Cette distinction entre l’approche américaine et la perspective japonaise se voit aussi à travers la répartition du travail créatif dans l’animation. Aux États-Unis, le taylorisme où chaque élément d’une scène est attribué à des personnes différentes aboutit à des œuvres plaisantes qu’on oublie vite. Au Japon, le fait qu’un animateur s’occupe seul d’une séquence entière fait qu’il peut vraiment s’exprimer et être un « auteur » qui a à cœur de montrer sa prouesse. C’est pourquoi il y a toujours des morceaux de bravoure inoubliable dans les anime.
Satoshi Kon est le premier à avoir fait remarquer cette distinction entre les approches américaines et japonaises. Il était partisan du fait de concevoir des œuvres personnelles et de promouvoir la culture japonaise pour espérer toucher un public plus large et non faire une œuvre insipide pour la vendre à l’international.
Puisque nous parlons maintenant de Culture, expliquez-nous un peu la genèse de cet essai : Culture Manga, Origines et influences de la bande dessinée japonaise.
L’ouvrage est publié chez un éditeur académique et il s’adresse avant tout aux chercheurs et étudiants qui souhaitent introduire le manga dans leurs productions universitaires. Mais il est fait pour être lu par le grand public qui souhaite mieux comprendre comment a évolué la culture populaire autour du manga, comment la bande dessinée japonaise est en mesure de proposer des imaginaires plus puissants et plus riches que les productions hollywoodiennes.
Je me suis appuyée sur mes recherches et les études déjà réalisées pour proposer une synthèse utile à tous ceux que le manga intéresse en tant que bande dessinée à part entière ou en tant qu’expression culturelle.
Dans cet ouvrage, vous débutez par un chapitre Grandeur et décadence du manga au Japon, qui place donc un âge d’or du manga derrière nous… Sur le plan commercial c’est une chose mais qu’en est-il sur le plan artistique selon-vous, est-ce que le genre se renouvelle, stagne ou s’épuise ?
Je débute effectivement par le constat que l’environnement médiatique qui a permis l’émergence du manga comme fabrique de l’imaginaire populaire japonais est révolu. En gros, l’époque où les industries de l’imprimé étaient prépondérantes par rapport à l’audiovisuel ou le jeu vidéo est totalement révolue. Cela se perçoit dans l’ordre des adaptations : le manga est aujourd’hui un support comme un autre au lieu d’être le principal lieu où se forment les mondes imaginaires. Le magazine papier qui était un laboratoire de création n’a plus le pouvoir de fédération d’autrefois et les publics ont une attention réduite et dispersée entre les réseaux sociaux et les multiples autres divertissements disponibles.
Je ne suis pas la seule à faire ce bilan et dans le domaine lié de l’animation la « mort » a été déclarée par des réalisateurs plus prestigieux que je n’oserai jamais l’être. Ensuite, il faut préciser que l’âge d’or est un concept qui fait référence à une très courte période de grâce où tous les astres sont alignés. Dans la plupart des religions et des mythologies, les humains vivent dans une période de déclin qui dure bien plus longtemps que l’âge d’or. Dans le cas du bouddhisme, le premier et le deuxième Âge durent chacun 500 ans, tandis que la période de la fin du Dharma s’étend sur 10 000 ans.
Dans le cas du manga, il y a toujours de nouvelles séries intéressantes et les équipes qui assistent les auteurs leur permettent de maintenir une bonne qualité au niveau du dessin comme du scénario. Disons que les formules qui marchaient déjà sont de plus en plus perfectionnées et, comme il est de plus en plus difficile de capter l’attention du public, les auteurs doivent vraiment se renouveler. Il n’y a plus de phénomène comme Ashita no Joe dans le manga de sport, mais on peut toujours se divertir en lisant Haikyû ! sans le prendre au sérieux et c’est déjà pas si mal.
Qu’est-ce qui a changé dans le format manga, entre un Dragon Ball et, par exemple, un My Hero Academia ou un One-Punch Man ?
À l’époque de Dragon Ball, les choses n’étaient pas encore figées et ni Toriyama ni son éditeur ne savaient où allait le récit. C’est pour cela que ça part dans tous les sens au début, que Goku change d’apparence pour devenir adulte, que le style évolue à mesure que les combats prennent de l’importance sur le reste. De la même manière City Hunter était une série qui se voulait très premier degré avec une thématique hardboiled mais ça n’a pas pris. C’est devenu autre chose et le style de Tsukasa Hôjô a évolué pour incorporer des mimiques hilarantes et des gags scabreux qui aujourd’hui le ferait censurer sur toutes les plateformes détenues par des sociétés californiennes.
Autrefois, les auteurs avaient un temps d’improvisation tandis qu’aujourd’hui les récits sont plus clairement définis et les premiers chapitres bien plus efficaces. Mais cette nécessaire efficacité (lié au temps et à l’attention réduite du lecteur) se fait souvent au détriment de l’innovation. C’est en sortant des sentiers balisés que l’on découvre de nouveaux paysages. Et c’est pour cela que les éditeurs ont tenté de renouveler le manga en faisant appel à des amateurs qui ont créé leur récit en dehors du système du magazine comme One-Punch Man. Une fois que la bande dessinée disponible sur le web a eu du succès, Yûsuke Murata a réalisé une version manga pour Shueisha.
Est-ce que, à force d’échange et d’inspiration, vous craignez un lissage culturel entre les différents types de bandes dessinées qui nous en ferait perdre les spécificités… Ou est-ce que, de ce mélange, sortiront des héritiers différents, comme le format webtoon par exemple, qui supplanteront un jour le manga ?
Je pense que lorsque les gens abordent les récits et les médiums qu’ils apprécient, ils ont tendance à vouloir les conserver dans l’état où ils les ont trouvés. Certains adorent le manga qu’ils sacralisent comme une forme d’expression typiquement japonaise et voient d’un très mauvais œil les manwha et autres bandes dessinées inspirées par l’esthétique du manga. D’autres adorent la bande dessinée franco-belge et sont révulsés par la multiplication des « grands yeux » dans les albums occidentaux. Je trouve que ces oppositions et ces conflits sont très sains dans la mesure où ils témoignent de l’intérêt toujours intense d’un public. Si personne ne s’intéresse à la bande dessinée née dans une région spécifique, ces débats n’existeraient pas. Donc, en ce qui concerne le style graphique, la mise en page et le découpage, je pense qu’il y a encore beaucoup de mélange possible avec des résultats intéressants et effectivement le webtoon et d’autres supports numériques viendront renouveler les pratiques de création et de consommation du manga.
Mais au niveau des récits et des thèmes, je ne pense pas qu’il puisse y avoir un lissage culturel sans une mort effective de la bande dessinée. Comme je l’ai dit auparavant, le manga est une forme de divertissement « vivante » car il y a un dialogue entre l’auteur et son public. Les conversations les plus intéressantes sont celles qui ont cours entre les vieux amis, les proches, les gens qui partagent une même passion. Ils osent se dire les choses en face car ils n’ont pas peur d’être incompris. Quand vous devez parler à tout le monde ou à n’importe qui, vous ne pouvez que dire des banalités pour ne pas risquer de friction sociale. Et je doute que la météo du jour soit un sujet passionnant même lorsque l’on vit à Londres.
L’avenir s’annonce donc des plus intéressants… Encore merci pour votre temps !
Merci de m’avoir accordé cet espace de parole !
Vous pouvez donc retrouver La Culture Manga, Origines et influences de la bande dessinée japonaise aux Presses Universitaires Blaise Pascal (collection L’Opportune) et Dragon Ball, une histoire française aux Presses Universitaires de Liège (Collection Acme). Bounthavy Suvilay est également présente en ligne via son site web ou sur les réseaux sociaux comme Twitter ou Facebook.


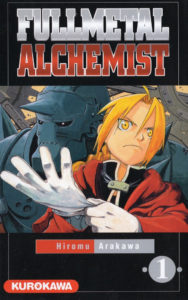

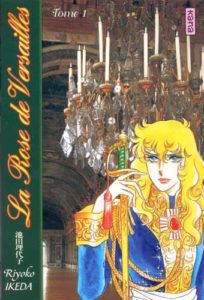
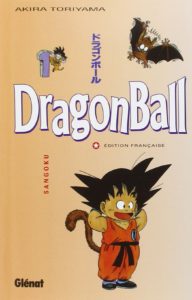
















Article absolument ridicule ! Ici l’auteurE exprime SON opinion sur la place des mangas et des DESSINS animÉs japonais en France, et rien de plus scientifique que son doigt mouillé. La vérité est que ce type de production a commencé à sortir de son statut inférieur de « japoniaiseries » (selon le terme employé en son temps notamment par Télé7jours pour parler de Goldorak) non pas par la grâce de Dragon Ball mais par celle d’Edgar de la Cambriole (Lupin III) et de Cobra, deux séries à succès diffusées quelques temps avant Dragon Ball. Ah mais là, ça ne colle pas avec ce que tient à nous asséner Bounthavy Suvilay ! Eh oui, des séries aux héros à l’occidentale (le Lupin de Monkey Punch est clairement calqué sur Georges Descrières, tandis que le Cobra de Terasawa Buichi est conçu autour de la personne de J.P Belmondo) ne lui parlent de toute évidence pas beaucoup plus que la littérature classique, qu’elle place sur le même plan que des séries fleuves pourtant écrites à la chaîne par des armées de scénaristes conscients que chaque épisode écrit est destiné à être effacé des mémoires par l’épisode suivant.
Maintenant, en ce qui concerne le prestige du dessin-animé japonais, n’en déplaise à Bounthavy Suvilay, c’est effectivement le long métrage AKIRA d’Ōtomo Katsuhiro qui a fait éclater les préjugés encore attachés à la fin des années 80 aux productions télévisuelles. Nul film d’animation nippon n’avait jusqu’à lui accédé aux grands écrans hexagonaux, nulle production nippone n’avait su rivaliser avec les œuvres canoniques de Walt Disney. Or Ōtomolivra une œuvre unique, puissante, d’une richesse de couleurs inédite (327 nuances dont 50 composées exprès pour AKIRA !) d’une fluidité dans l’animation et d’une mise en scène digne d’une superproduction hollywoodienne. C’est ça et rien d’autre qui parvint à convaincre le public français qu’une animation de qualité existait au Japon, qu’on ait l’objectivité de le reconnaître ou non. C’est AKIRA qui ouvrit par la suite un boulevard aux œuvres cinématographiques de Miyazaki Hayao (Porco Rosso, Laputa, Le Voyage de Chihiro etc.) ni Dragon Ball, ni le Docteur Slump.
Quand on se pique d’écrire l’Histoire des choses et des phénomènes, je crois qu’il est impératif de se tenir avec honnêteté aux évènements tels qu’ils se sont produits, et non de se contenter de ses propres souvenirs de jeunesse (phénomène « né d’hier ») et de ses propres affections. Enfin, signalons que cet article recèle un nombre conséquent de fautes de français et d’anglicismes/nipponismes superflus, qui jette un voile de défiance supplémentaire sur tout ce qui est allégué ici.
Bonjour,
Paul OZOUF, auteur de l’article et rédacteur en chef.
Merci de nous avoir lu.
Moins pour l’agressivité et le commentaire extrêmement subjectif… Enfin faux surtout, tellement c’est présenté avec un biais personnel énorme.
En gros un commentaire qui aurait pu être intéressant, tout n’y est pas forcément faux, encore faudrait-il des chiffres et que vous ne mélangiez pas autant la notion de succès critique et de succès public (Cobra je veux bien mais Lupin III dans les années 80 comme vecteur du succès à la place de Dragon Ball, je l’aurai pas tenté celle-là, tellement elle est perchée). Idem sur Akira : oui il a marqué aussi de son emprunte une génération mais le film en 1991 c’est 100 000 entrées, rien à voir avec le succès de Dragon Ball et ça n’a jamais ouvert la porte à Ghibli en soit. En plus Dragon Ball on parle de succès dans le temps dans cet article, qu’il faudrait relire et en entier svp. Car là, encore une fois, les chiffres parlent d’eux-mêmes. Mais on peut comparer les ventes de, par exemple, Cobra et de DB si vous voulez : j’adore les deux mais je pense qu’on va avoir une LEGERE différence…
Bref, il y aurait tant à dire mais, coupons là les potentiels pertes de temps que je sens potentiellement trollesque.
Donc je ne qualifierai pas votre texte de » Commentaire absolument ridicule » pour reprendre votre intro charmante, mais ma foi, partons plutôt sur l’humour en disant plutôt que c’est votre opinion, qui n’a « rien de plus scientifique que son doigt mouillé. »
Par contre pour les fautes – hors des anglicismes et nipponismes pas du tout « superflus » quand sait vivre avec son temps et pas comme un vieux réac… et que l’on comprend que l’on est sur un site spécialisé dédié au Japon – Bref, quand aux fautes disais-je, nous nous excusons toujours platement, et sommes toujours prêts à les corriger. Donc allez-y faites vous plaisir, humiliez nous avec votre grammaire ou votre syntaxe et nous en deviendrons meilleurs en tachant de nous corriger. 😉
Sur ce, on vous embrasse évidemment et on vous dit à bientôt… Enfin pas trop quand même !