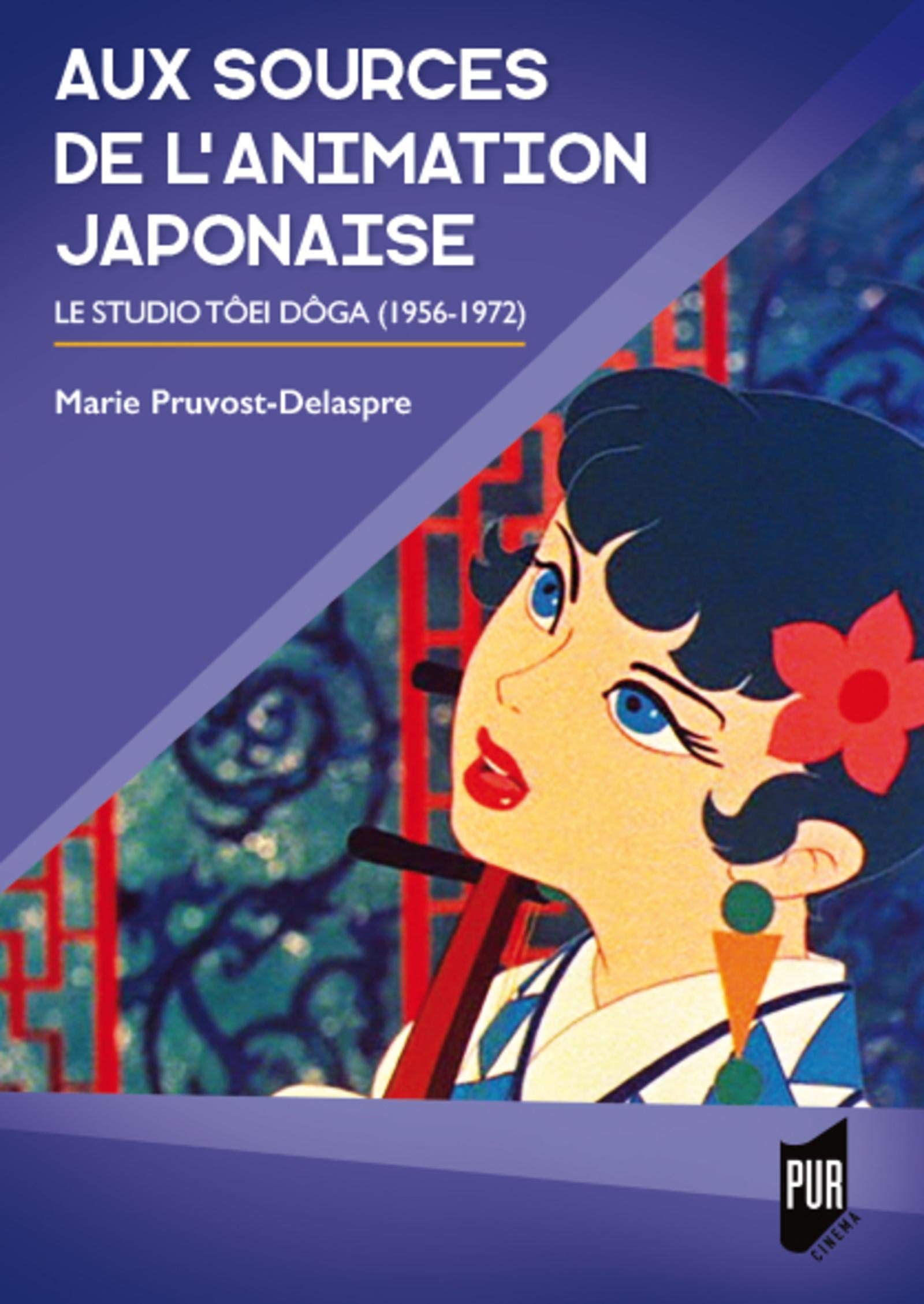Interview : Julien Bouvard, enseignant-chercheur spécialisé sur l’histoire du manga
Il est un pan de la recherche, celle de la culture populaire, dont beaucoup ignorent l’existence ou estiment peu… Avec Julien Bouvard, maître de conférence à l’Université Lyon 3, nous nous intéresserons à son sujet d’étude, le monde du manga. Qu’est-ce que le quotidien d’un enseignant-chercheur en études japonaises ? Quel est son parcours et qu’est-ce qui l’a mené à étudier le manga comme objet politique ? Enfin, il nous donnera quelques conseils bien utiles pour apprendre le japonais à l’université.
Recherches et manga
Le métier de chercheur
Journal du Japon : Bonjour et merci beaucoup de nous accorder cet entretien. Pouvez-vous tout d’abord vous présenter à nos lecteurs ?
Julien Bouvard : Je m’appelle Julien Bouvard, je suis maître de conférences en études japonaises à l’Université Lyon 3. Concrètement, je suis enseignant-chercheur. J’enseigne la langue et la civilisation japonaise et je mène des recherches sur la subculture japonaise et plus précisément sur l’histoire du manga.
En quoi consiste le métier de chercheur en université ?
Le métier d’enseignant-chercheur comme son titre l’indique se décompose en deux missions. La première consiste à donner des cours à des étudiants d’université depuis la première année de la licence jusqu’en master, voire des séminaires pour les doctorants. C’est le cas avec Lyon 3 où les études de japonais peuvent aller jusqu’au doctorat. De l’autre côté, nous faisons partie de centres de recherche qui ont des positionnements particuliers, soit sur l’Asie, soit sur d’autres disciplines. Concrètement, on publie des articles dans des revues scientifiques, on organise et participe à l’élaboration de conférences, dans lesquelles on intervient régulièrement. Et plus rarement, on écrit des ouvrages sur nos spécialités.
Comment en êtes-vous venu à choisir le domaine d’étude de la culture populaire japonaise, et plus précisément du manga ?
Par où commencer ? Après mon bac L option grec ancien (j’étais déjà un peu original à l’époque) je suis rentré à l’université, en licence d’histoire, car c’est ce qui m’intéressait le plus à l’époque. Pour être tout à fait franc, je n’avais même pas idée que des formations universitaires en japonais existaient. Venant de la campagne, l’accès aux informations était assez limité par rapport aux lycéens de grandes villes. J’étais donc à Lyon 2 en histoire, et j’ai remarqué qu’à Lyon 3, l’université voisine, il existait une section de japonais et donc j’ai décidé de m’inscrire en première année de LLCER quand je suis entré en deuxième année d’histoire. J’ai ainsi mené les deux parcours en parallèle. Je me suis arrêté à la maîtrise (équivalent du master aujourd’hui) en histoire, et puis j’ai continué en japonais avec un échange universitaire et ensuite une thèse de doctorat que j’ai décidé de faire sur l’histoire du manga et plus précisément l’histoire des relations entre la politique et le manga. C’est un sujet qui m’intéressait en tant qu’historien, mais aussi en tant que japonologue. Pour le dire simplement, mon intérêt pour la langue et la civilisation japonaise venait de là. J’avais vraiment besoin de pouvoir accéder à des sources en japonais, de pouvoir lire, comprendre, discuter avec des personnes japonaises, de manière à aller un petit peu plus loin dans l’étude de l’histoire du manga. Voilà comment j’expliquerais mon parcours à l’université.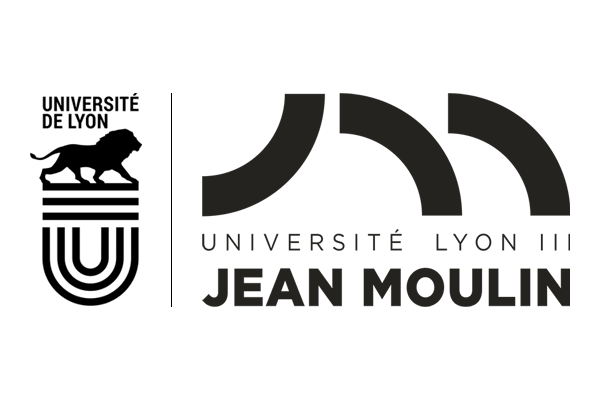
Votre choix pour l’apprentissage du japonais était donc avant tout de la curiosité ?
J’aimais déjà le Japon quand j’étais au lycée, et puis je lisais beaucoup de mangas. Je faisais aussi partie d’une association dijonnaise qui publiait à l’époque un fanzine sur le manga et le dessin animé japonais. J’ai donc toujours eu ce goût-là, mais pour ce qui est de l’étude de la langue, à part les katakana et hiragana que j’avais appris avec la méthode ASSIMIL, j’avais très peu de connaissances, même si cela m’intéressait. En tout cas, l’idée de transformer cet intérêt pour le Japon en diplôme universitaire est arrivée assez tardivement chez moi : une fois adulte en fait, mais ce n’était pas du tout évident jusque-là.
Le manga est également un objet de divertissement : est-il simple de passer d’une simple appréciation du médium à une étude universitaire de celui-ci ?
Oui, cela ne m’empêche pas de profiter du manga en tant qu’entertainement [NDLR : divertissement]. Plus jeune, j’avais déjà un intérêt pour les écrits sur le manga. Avant de rentrer à l’université, j’avais la chance d’avoir parfois une connexion Internet, ce qui m’a permis de découvrir un océan de textes sur certaines séries populaires. Je pense notamment à Evangelion sur laquelle il y avait déjà énormément de choses disponibles en anglais. Le fait d’aller plus loin et d’essayer de trouver des informations de première-main, tout cela c’était quelque chose que j’avais déjà intégré depuis longtemps. Une fois adulte, je me suis penché sur les articles universitaires concernant ce domaine. Ils m’ont tout de suite convaincu : ça me changeait des discours de fans que j’avais l’habitude de lire dans les revues spécialisées. Pour moi, c’était donc été assez logique et évident de m’approprier le manga en tant qu’objet de recherche, et ce aussi parce que d’autres personnes avant moi avaient commencé à le faire à la fin des années 90 et surtout au début des années 2000 où il y avait déjà quelques chercheurs. Aucun Français, mais du côté du monde de la recherche anglo-saxonne, on trouvait déjà 3 ou 4 personnes qui publiaient des articles tout à fait sérieux et intéressants. Ils ont ouvert la voie à d’autres chercheurs comme moi qui se sont engouffrés dans ce nouveau champ.
Donc vous faites partie de la première génération chercheurs sur le manga en France ?
En France, il est assez difficile de parler de « générations ». Tout simplement parce que nous ne sommes pas très nombreux, environ une dizaine à nous intéresser au manga. La plupart des chercheurs ont soit mon âge, soit sont un petit plus jeunes que moi, mais il ne faut pas oublier les pionniers comme Jean-Marie Bouissou, à la retraite aujourd’hui, qui a publié un ouvrage important sur l’histoire du manga il y a une dizaine d’années. Néanmoins, au sein de sa classe d’âge il était, je crois, le seul à avoir cette curiosité pour le médium. Ensuite, il faut attendre des gens comme moi (j’ai 40 ans), qui ont d’abord été des lecteurs de mangas traduits en français avant de s’en emparer d’un point de vue universitaire plus tard. Aujourd’hui, je dirais que ceux qui travaillent sur le sujet ont entre 25 et 40 ans. Et il y a sans doute une nouvelle génération qui va venir, peut-être encore trop jeune pour qu’on puisse l’identifier clairement.
Le manga comme objet politique
Dans votre thèse, vous abordez le manga comme objet politique. Pouvez-vous nous faire part de votre approche d’un tel sujet ?
Concrètement, mon idée était d’abord de brosser un tableau des idéologies politiques présentes dans le manga des années 1960 jusqu’à nos jours. Par ailleurs, je me suis intéressé à comment est-ce que le politique, c’est à dire les institutions et les autorités traitent le manga sur la même période, en essayant bien sûr de relier les deux. Concrètement, il s’agit autant de comprendre ce que « disent » les mangas que d’analyser quelles sont les lois qui régissent leur publication et les censurent, etc.
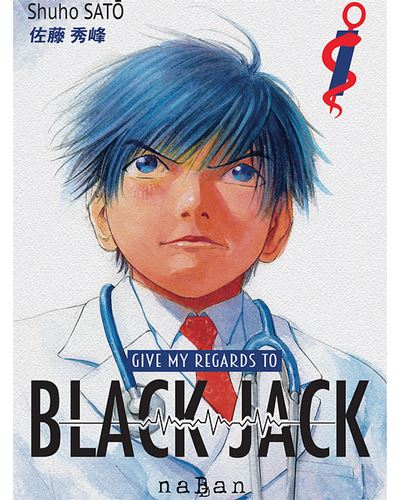 Les mangas « politiques », comme peuvent l’être Give my regards to Black Jack ou Poison City, ont-ils un poids sur l’opinion public japonais ou bien le gouvernement ?
Les mangas « politiques », comme peuvent l’être Give my regards to Black Jack ou Poison City, ont-ils un poids sur l’opinion public japonais ou bien le gouvernement ?
C’est une bonne question, mais je répondrais par la négative, quitte à vous décevoir ou décevoir vos lecteurs. Je pense néanmoins qu’ils entrent dans une forme de résonance avec d’autres œuvres qui n’hésitent pas à critiquer, ou en tout cas qui ont un œil critique vis-à-vis de la société japonaise, sur certaines questions de société que cela soit sur le milieu médical, les inégalités sociales, le harcèlement, l’impossibilité de pouvoir s’exprimer d’un point de vue politique dans le Japon contemporain, etc. Bref, il y a un certain nombre de sujets graves qui sont très souvent traités dans les mangas, mais pour autant, est-ce qu’ils ont une influence directe sur l’action politique ou sur les lois au Japon ? Je répondrais non. En revanche, cela peut rentrer en compte dans des mécanismes plus généraux de défiance vis-à-vis du pouvoir, sans forcément se traduire dans des mouvements politiques identifiables.
Auriez-vous un exemple récent révélateur de la relation entre le manga et le pouvoir politique au Japon ?
Lequel est-ce que je pourrais choisir (il réfléchit). Je pourrais parler de Misshitsu qui est un manga pornographique qui a été condamné pour obscénité au milieu des années 2000 dont le jugement a permis de resserrer les boulons de la censure concernant l’industrie du manga. Au point même que les auteurs de dôjinshi, mangas amateurs très populaires et diffusés au Japon, s’autocensurent désormais et prennent beaucoup de soins à mettre des avertissements du type « interdit au moins de 18 ans », ou « interdit aux mineurs ». Tout cela a amené une sorte de renforcement de l’autocensure, car le risque judiciaire apparaît dès lors comme une épée de Damoclès. La condamnation de Misshitsu signifiait en gros que n’importe quel manga incluant de la pornographie pouvait être condamné pour waisetsu, c’est-à-dire « obscénité », un terme vague qu’on peut interpréter de manières variables. Encore plus récemment, l’affaire « Rokudenashiko », cette mangaka excentrique qui a justement été condamnée pour « obscénité » a relancé le débat sur la censure des œuvres culturelles et artistiques au Japon qui sont soumises à une législation très conservatrice.
La recherche sur le manga et la culture populaire japonaise en France
La culture japonaise populaire étant très répandue en France aujourd’hui, y aurait-il par conséquent beaucoup de chercheurs ou d’aspirants chercheurs dans ce domaine ?
Je peux vous citer les noms de quelques personnes intéressantes dans les études sur la culture populaire japonaise, à commencer par ma collègue Marie Pruvost-Delaspre qui est maîtresse de conférences en cinéma à Paris 8, spécialisée sur l’animation japonaise. Elle a fait sa thèse sur l’histoire de la Tôei Dôga (aujourd’hui Tôei Animation) : c’est un très beau travail qu’elle a publié il y a quelques mois. Je conseille à tous ceux qui s’intéressent à l’histoire de l’animation japonaise de lire son ouvrage passionnant. C’est un travail en étude cinématographique très riche et pointu quant aux aspects techniques sur le cinéma et l’industrie du cinéma en général. Sinon, dans le domaine musical, il y a Chiharu Chûjô que vous avez déjà interviewée. Sur le manga en particulier, nous ne sommes vraiment pas nombreux, mais je peux citer Blanche Delaborde a soutenu il y a deux ans une thèse de doctorat concernant les onomatopées dans la bande dessinée japonaise.
La popularité des cultures populaires japonaises se traduit-elle par un engouement dans le domaine de la recherche ?
Oui et non. Du côté des étudiants, il y a bien une inflation de mémoires de master concernant le manga, le dessin animé ou le jeu vidéo, mais du côté des chercheurs sur le Japon, l’engouement est beaucoup moins visible.
Y aurait-il, dans le domaine universitaire, un mépris pour les études de la culture populaire ?
Oui, je pense que cela perdure encore un petit peu de nos jours. Peut-être aussi parce qu’il y a une question de générations dont on parlait plus haut. Et de manière plus globale, je pense qu’il reste encore des hiérarchies dans les conceptions de la culture, ce qui fait que même les enseignants-chercheurs, qui sont normalement à l’avant-garde de la connaissance, restent très prudents face à des objets « récents ». Travailler sur des produits de la culture populaire qui sont beaucoup lus et connus par le public n’est pas forcément quelque chose de très valorisant dans leur carrière. On risque d’un côté la condescendance de la part des collègues et de l’autre la méfiance de la part des « fans » qui n’apprécient guère que l’on s’empare de leur passion. Certains sont parfois hermétiques à toute dimension intellectualisante à propos de leur hobby.
Beaucoup d’idées fausses ou préconçues circulent autour du Japon, par quels moyens les spécialistes peuvent-ils remédier à ce problème ?
J’ai des cours destinés aux étudiants en première année de licence, et c’est souvent l’occasion de tordre le cou à tous ces présupposés. Nous traitons différents sujets comme la famille, l’habitat, l’immigration, etc. Je leur donne parfois des informations qui vont à l’encontre de leur préconception sur le Japon. Notre mission d’enseignant-chercheur est justement d’essayer de trouver des sources fiables, des chiffres incontestables afin de leur montrer que le Japon qu’ils imaginent n’est pas forcément celui de la réalité. C’est un type de discours que j’adopte souvent avec des L1 qui arrivent avec plein d’a priori que nous devons déconstruire.
Comment abordez-vous vos participations à des émissions grand public, avec par exemple récemment celle sur Evangelion, ou celle sur L’Attaque des Titans ?
J’essaye de m’adapter au propos et au public tout simplement : cela ne sert à rien d’être trop technique et d’aller trop dans la théorie dans des émissions comme celles-ci. Et en même temps, il faut avoir un certain impact dans ce que l’on raconte en très peu de temps : ça se joue parfois à la seconde près. Donc cela demande un petit peu de préparation pour être tout à fait franc (rires). Il faut se préparer à placer ce qu’on a envie de mettre en avant, en fonction des thèmes abordés, de manière directe et concise. Je suis plutôt content d’ailleurs qu’on m’invite à m’exprimer à ce propos. Je ne suis pas un spécialiste de toutes les séries bien sûr, mais je pense quand même avoir un recul et une certaine expertise sur l’animation japonaise ou sur le manga qui me permet toujours d’avoir un regard qui je l’espère est pertinent pour les auditeurs. C’est parfois un peu frustrant, car d’un côté on est très content que l’objet soit légitimé, notamment par des chaînes de radio comme France Culture, et de l’autre, on ne peut pas passer une heure sur cette question de la légitimité et de l’importance de l’objet. J’aimerais qu’un jour, on puisse traiter une série d’animation ou un manga comme n’importe quel autre objet culturel, sans passer par la fameuse question de sa reconnaissance. Pour le dire franchement, j’en ai un peu marre de devoir me justifier de parler de ces sujets comme s’ils étaient mineurs ou sulfureux.
Étudier le japonais à l’université
À votre avis, comment bien aborder l’étude d’un pays et d’une culture étrangère ?
Je dirais avec curiosité, c’est vraiment le mot clef. Il faut rester curieux et ne pas arriver avec son schéma de pensée, ne pas avoir peur d’être brusqué dans ses conceptions sur le monde, sur la société, pour justement arriver à intégrer et comprendre ce que c’est qu’une culture différente. Évidemment, la langue est nécessaire. L’acquisition d’une langue étrangère, qui plus est le japonais, est un outil pour changer notre manière de penser.
Pouvez-vous nous en dire plus sur l’apprentissage du japonais à l’université ?
Oui je pourrais vous en parler pendant des heures (rires). Nos étudiants arrivent avec aucune connaissance, à part ceux qui ont fait du japonais au lycée. On utilise des manuels en première et deuxième années : chez nous, c’est le Minna no Nihongo, qui est la méthode la plus connue et qui commence à être un petit peu désuète d’ailleurs. Je pense qu’on ne devrait pas tarder à en changer dans quelque temps. On donne des cours de grammaire, de version, de thème et d’oral. Pour ce qui est des autres matières hors langues, il y a des cours d’histoire, de littérature. Et quand on arrive en deuxième et troisième années, on aborde des sujets plus précis comme le cinéma, la littérature zainichi, le manga, etc. Voilà concrètement comment cela se passe, sachant que d’année en année, on peut travailler sur des textes plus compliqués, donc de plus en plus agréables pour les étudiants. Ils peuvent passer des petits textes sur Miller-san du Minna no Nihongo qui ne sont pas forcément très passionnants, à des extraits de romans, des articles de journaux… Hélas, ça prend quelques années pour arriver à ce niveau.
donne des cours de grammaire, de version, de thème et d’oral. Pour ce qui est des autres matières hors langues, il y a des cours d’histoire, de littérature. Et quand on arrive en deuxième et troisième années, on aborde des sujets plus précis comme le cinéma, la littérature zainichi, le manga, etc. Voilà concrètement comment cela se passe, sachant que d’année en année, on peut travailler sur des textes plus compliqués, donc de plus en plus agréables pour les étudiants. Ils peuvent passer des petits textes sur Miller-san du Minna no Nihongo qui ne sont pas forcément très passionnants, à des extraits de romans, des articles de journaux… Hélas, ça prend quelques années pour arriver à ce niveau.
Qu’apporte selon vous l’étude du japonais à l’université aux étudiants ?
Une ouverture sur le monde, un décentrement de leur schéma de pensée. On ne voit plus le monde de manière unilatérale, mais toujours en comparaison, « en rapport à », « avec ». Donc voilà ce que ça leur apporte et je pense que c’est le plus important. Et puis pour beaucoup d’entre eux, c’est aussi l’occasion de pouvoir partir. Soit en échange : à Lyon 3, on fait partir presque la moitié de la promotion de L3 (étudiants en troisième année). En tout, il y a presque une cinquantaine d’étudiants qui partent en échange au Japon tous les ans, et puis le même nombre qui viennent chez nous, même si en ce moment avec le Covid, ce chiffre est réduit à zéro. C’est souvent pour eux une forme de révélation : une bonne partie d’entre eux décident d’y rester, ou bien de revenir un petit peu à Lyon, et puis de repartir rapidement. C’est aussi ce qui va orienter le futur de leur vie, professionnelle et sentimentale parfois…
Vous enseignez en tant qu’enseignant-chercheur, comment abordez-vous la question de l’enseignement de la langue ?
J’ai des cours de traduction en L3 et en Master. En L3, on utilise un livre de vulgarisation de statistiques sur le Japon (rires). Ça ne paraît pas très sexy présenté comme ça, mais c’est assez drôle. C’est un bouquin assez amusant avec des textes simples et des graphiques sur l’état du Japon dans plein de domaines très différents, sur des sujets parfois très quotidiens ou au contraire, plus sérieux. Je trouve que c’est une manière assez ludique de s’entraîner, avec du vocabulaire qui ressemble à celui que l’on retrouve dans les journaux ou dans les articles de presse sur Internet. Mes cours se passent de manière assez classique : je donne les textes en amont aux étudiants, pour qu’ils préparent, vérifient le vocabulaire, apprennent les mots et les nouveaux caractères. Et puis en cours, on essaye de bien traduire, car c’est un cours de version. La connaissance du japonais est un prérequis, mais cela ne suffit pas hélas à faire une bonne traduction. J’insiste beaucoup sur la qualité du français. Donc on travaille beaucoup là-dessus puisqu’il y a beaucoup de nos étudiants qui vont se diriger vers les métiers de la traduction technique ou de mangas. Je leur donne d’ailleurs tous les ans quelques planches de bandes dessinées japonaises à traduire. C’est plus compliqué qu’ils ne l’imaginent !
Et des cours magistraux de civilisation ?
Ça dépend des années. En première année, je donne un cours assez général sur l’histoire du Japon contemporain, de Meiji jusqu’à nos jours, avec un deuxième semestre qui est orienté sur des questions plus précises comme l’histoire de la famille, sur l’habitat, sur la famille impériale, etc. Ensuite en deuxième année, j’ai un cours sur l’histoire du manga et en troisième, j’ouvre sur l’histoire de la subculture dans sa globalité. Par ailleurs, les cours de civilisation destinés au Master sont donnés sur des sujets plus pointus qui changent à peu près tous les ans. Par le passé, j’ai notamment fait un cours sur la culture Otaku, un autre sur le genre et la sexualité au Japon. Et en ce moment, je me concentre sur la matérialité du manga, qui est mon sujet de recherche actuel.

Photo de l’Anime Shin Seiki Sengen (littéralement « nouveau siècle de l’anime »), événement clef de la culture Otaku ayant eu lieu en octobre 1981.
Auriez-vous des conseils à donner aux personnes qui souhaitent se lancer dans des cursus de langue japonaise à l’université ?
Oui, le premier : c’est de lire des choses en relation avec le Japon. Ça peut paraître un peu bête, mais c’est vraiment la base. C’est-à-dire de ne pas se contenter des podcasts ou des vidéos YouTube, mais utiliser des ouvrages qui ont été écrits par des spécialistes de la question. En dehors de ces lectures sérieuses, ça peut être aussi de la fiction : bien sûr des mangas, des romans, peu importe, mais il faut lire autant que possible. D’une manière générale, il faut essayer de se plonger totalement dans le Japon même si on n’y est pas encore physiquement. Voilà mon conseil. Et puis avant de rentrer en première année, je pense qu’effectivement, c’est mieux si on a appris un petit peu le japonais, ne serait-ce qu’en autodidacte. Enfin, il faut être motivé pour apprendre du vocabulaire et retourner à un aspect un peu scolaire de la langue alors qu’on est à l’université. Ce n’est parfois pas évident d’apprendre des listes de kanji et des mots de vocabulaire toute la journée, mais c’est nécessaire. Pendant quelques années, les étudiants vont être obligés de le faire de manière intensive.
Et que faudrait-il éviter selon vous ?
C’est un peu évident, mais il ne faut pas arriver les mains dans les poches en se disant qu’il suffit d’aller aux cours pour avoir son diplôme. Oui, c’est ça : éviter le dilettantisme en fait. Il faut être vraiment curieux, et cultiver cette curiosité en essayant de creuser les sujets par soi-même.
Un grand merci à Julien Bouvard pour nous avoir accordé du temps pour répondre à toutes nos questions. Vous pouvez le suivre sur son compte Twitter où il fait régulièrement part de ses réflexions. Journal du Japon lui souhaite une bonne continuation dans ses recherches. Et bon courage à ses élèves pour l’apprentissage du japonais !