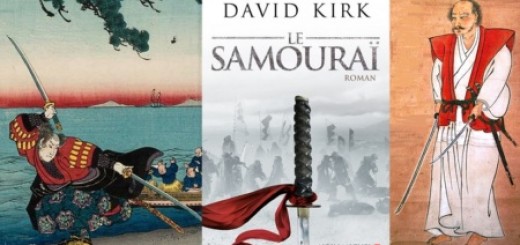Diamond Little Boy : un manga de furyo à la française ?
Victor Dermo est persévérant, il revient de loin, et c’est sans doute ce qui donne à son premier manga une saveur très particulière. Une enfance du côté de Caen, le rap dans les écouteurs, le quartier, les potes. Puis l’adolescence, le deal de stupéfiants et des ennuis avec la justice. Un parcours qu’il raconte dans Diamond Little Boy, une série prévue en quatre tomes… qui n’est pas ce que vous pensiez.

Diamond Little Boy X Victor Dermo : la furie et la foi
Histoire de banlieue ? Non, trop réducteur. Manga de furyo ? Pas tout à fait. Violence partout, sourire nulle part ? Encore loupé. Diamond Little Boy est avant tout l’autobiographie d’un passionné de pop culture japonaise, et un portrait plutôt juste de la vie dans les quartiers périphériques, où le rire se dispute au drame, et le rockabilly au rap. « Un mix entre Beck et les films de Martin Scorcese » nous dira en riant Victor au cours de cette rencontre, en juillet à Japan Expo.
Le premier tome est disponible aux éditions Vega – une nouvelle étape d’un long combat pour faire exister cette histoire. En 2016, à vingt-deux ans, Victor Dermo publie gratuitement en ligne une première version. Deux ans plus tard, il auto-édite une seconde mouture en tome relié. Il aurait pu s’en tenir là, mais Diamond Little Boy est ensuite diffusé au Japon sur la plate-forme Bookwalker, avant d’être encore remanié pour aboutir à la version aujourd’hui disponible en librairies. Ça aurait presque pu s’intituler La furie et la foi…

Résumé officiel : Victor grandit dans une cité caennaise dans les années 2000. Il passe une grande partie de sa scolarité à dessiner dans les marges de ses cahiers, puis arrête l’école en troisième. Il tombe alors dans la délinquance et les petits trafics de stupéfiants, puis s’approche du crime organisé, avant d’être condamné par la justice. Sa minorité lui évite la détention et lui donne l’occasion de remonter la pente. L’histoire de Victor, c’est celle de Victor Dermo, qui via cet alter ego peut raconter son histoire dans le support qui a bercé son enfance : le manga.
Une autobiographie, entre Beck et Scorcese…
Laurent Lefebvre : Bonjour Victor et merci pour ton temps… Je voudrais d’emblée éclaircir un point important : quelle est la part de fiction, et la part d’autobiographie, dans Diamond Little Boy ?
Victor Dermo : C’est vraiment une autobiographie, avec des aspects romancés parce que la vie a été pire que ce que je raconte dans le manga. La mort de mon pote, en réalité on parle de la mort d’un jeune et d’une maman qui enterre son enfant, c’était hyper trash. La manière dont je l’aborde est plus douce, je voulais que ce moins malsain par rapport à ce que nous avions vécu à l’époque. Idem, la première fois que j’ai vu du cannabis, j’avais huit ou neuf ans, et non pas treize. Et puis j’ai changé les noms, les visages, j’ai mis de côté les détails de certaines embrouilles…



C’est une manière de protéger ton entourage ?
On s’est consultés, on a discuté. Certains personnages secondaires sont toujours impliqués aujourd’hui dans des trucs illégaux, donc j’allais pas utiliser leurs vrais noms. La première version de Diamond Little Boy était peut-être moins autobiographique… Par exemple, à l’époque, je ne savais pas si je pouvais raconter des histoires pour lesquelles je n’avais pas été condamné.
Sur les réseaux sociaux, tu as le soutien des communautés de fans de manga furyo. À tes yeux, Diamond Little Boy appartient-il à cette lignée ?
Au début, je présentais Diamond Little Boy comme « le premier street manga ». Ce n’est pas du seinen, ni du shônen, c’est un pont entre la culture hip-hop, la culture street et les codes du manga. Un jour, je suis tombé sur un site spécialisé dans les mangas de délinquance juvénile. J’avais déjà bien kiffé le film Crows Zero et avec le site j’ai appris que le furyo était un genre à part entière. Je pense que mon manga est proche des codes du furyo, en tous cas on l’a travaillé dans ce sens. Après, les bagarres à coups de batte, à cinquante contre cinquante, des lycées entiers qui se tapent contre d’autres lycées, ce n’est pas mon approche. Les mangas de furyo sont des fictions, surtout dans un pays comme le Japon, dont le taux de criminalité est l’un des plus bas au monde. Mais si on devait rapprocher Diamond Little Boy d’une catégorie de manga, on pourrait dire que c’est du furyo français.
Ton manga est effectivement moins porté sur l’action et les bagarres que la plupart des mangas de furyo.
Je ne prends pas énormément de plaisir à dessiner ce genre de scène, prendre quatre pages pour deux patates et un coup de pied, limite ça ne m’intéresse pas et ce n’est pas mon point fort en dessin. Mon angle, c’est le drame social, réaliste, et traiter aussi de violence parce que le héros est né dans un certain milieu. Le premier tome pose les bases afin qu’on comprenne bien ce milieu où il évolue : sur le chemin de l’école, il y a des endroits à éviter sinon il risque de se faire accrocher par des mecs qui cherchent la baston, et une fois arrivé chez lui son père va le chicoter si il s’est pris un mot au collège. Diamond Little Boy n’est pas du tout un manga de baston. À aucun moment le but de Victor est de devenir le plus fort et d’éclater tout un quartier. Je préfère montrer comment Victor apprend et évolue à travers les rencontres, comment il observe et décode son environnement.
Tu as eu d’autres sources d’inspiration ?
À l’époque, je lisais Beck et Nana, et j’aimais beaucoup cette manière assez réaliste de raconter le quotidien de gens qui ont une passion et des projets dans la musique. Une vie et des rêves, au jour le jour. J’adore aussi le cinéma et je voyais un peu Diamond Little Boy comme un mix entre Beck et les films de Martin Scorcese (rires). Le tome qui vient de sortir, c’est la version la plus aboutie. Mais quand j’ai commencé, je me suis demandé si je n’étais pas fou.


Pourquoi ?
Je ne savais pas si mon projet avait du sens ni où j’allais. Je n’avais aucun exemple à suivre alors que pas mal de choses auraient été plus simples si j’avais pu lire une autobiographie en manga d’un mec ayant eu un parcours un peu difficile, un peu caillera. La première fois qu’on m’a dit « continue, ça va le faire », j’ai pleuré, j’appelle ça un moment de grâce (rires). J’ai eu une longue période de doutes, je m’imaginais que soit mon projet allait être un succès, soit qu’il allait droit dans le mur, que les gens n’allaient pas comprendre ma démarche. Aujourd’hui je dis souvent que plus un artiste est singulier, plus ça va être dur de percer mais au moins il est possible de s’installer dans la durée… alors que faire un énième shônen comme les autres, c’est risquer de vite disparaître ensuite. En 2025, les mangakas n’affrontent pas d’autres mangakas. En terme de notoriété on se bagarre contre des youtubeurs et des tik-tokeurs, tout le monde cherche à avoir une visibilité. Un projet différent, qui ne ressemble qu’à son auteur, je pense que ça va forcément impacter les gens.
On a l’impression que tu n’aurais pas forcément dessiné de mangas sans cette idée d’autobiographie…
Je ne sais pas… Mon éditeur me dit souvent que suis devenu auteur de manga uniquement parce que j’avais cette histoire à raconter. C’est douloureux, le manga, pour le corps et pour la tête. C’est énormément d’heures de dessin, ça t’isole de tout, dix ou quinze heures par jour, pendant dix mois sur douze. Quelque part, c’est pas normal… Qui le fait vraiment par plaisir ? Moi je l’ai vécu comme une mission : il fallait que je raconte mon histoire, je suis né pour ça. Je ne pense pas que je me serais investi avec autant d’intensité pour créer un manga de fantasy par exemple, c’est ma vie qui m’a amené à faire du manga.
Entre Caen et… le Japon
Peux-tu revenir sur tes premiers contacts avec le milieu de l’édition au Japon, et avec le studio Atsu qui a participé à la création des décors du premier tome ?
J’ai deux éditeurs, Stéphane Beaujean (directeur éditorial des éditions Dupuis – Ndlr) et Frédéric Toutlemonde (créateur d’Euromanga, maison d’édition spécialisée dans la traduction de bande-dessinée européenne au Japon – Ndlr). Frédéric a présenté à plusieurs tantô les deux tomes que j’avais publié en indépendant, pour avoir leur avis. Ils ont vu les progrès entre les deux, et que j’avais encore de la marge, du coup ils ont recommandé que je bosse sur mes points faibles pendant trois mois. Je me suis tué à la tâche pour atteindre un niveau satisfaisant avant de rencontrer les gens du studio Atsu. Ils n’avaient jamais collaboré avec un auteur étranger et il fallait les convaincre d’accepter le projet. Ce ne sont pas des mercenaires qui acceptent un job à partir du moment où tu les payes. Ils n’ont pas le temps, ils dessinent pour les plus grosses franchises au monde (rires). Avec Atsuhiro Sato, le patron du studio, immédiatement il y a eu un super bon feeling. Un peu de grand frère à petit frère. Que je raconte mon vécu, dans un délire un peu yankee ou furyo, à chaque fois ça intriguais les Japonais. Et la rencontre avec Sato-san, c’était presque magique.
Ce feeling de grand-frère à petit-frère dont tu parlais ?
Je pense qu’il n’avait jamais vu un profil comme le mien, et en plus on est à peu près le même genre de gars, même si on ne parle pas la même langue. Quand on s’est rencontrés, on portait tous les deux des écarteurs d’oreille et on avait la même dégaine : bob, short, chemise à manches courtes, tatouages partout (rires). On s’est regardé comme ça… (il plisse les yeux puis esquisse un sourire – Ndlr).
En fait, Sato-san a fait ses débuts dans le furyo et il a vraiment l’œil pour travailler sur les mangas plus ou moins cailleras. Le premier chapitre de Diamond Little Boy lui a rappelé du Shohei Manabe, l’auteur de Ushijima l’usurier de l’ombre. C’est une de mes références, donc ça fait plaisir.
Cette collaboration avec le studio Atsu, qu’a t-elle apporté à ton manga ?
Ils ont travaillé sur les décors et ça a été très formateur. Je ne travaille qu’à partir de photos de chez moi, c’est vraiment ma ville et mon quartier qui sont dessinés, on peut s’y balader et retrouver les décors de Diamond Little Boy. Le studio Atsu m’a permis de gagner du temps et en qualité. On desinait sur le même logiciel et j’ai pu étudier les fichiers qu’ils m’envoyaient, les calques, la densité des trames, les manipulations de photographies pour obtenir cette ambiance très spécifique à certains seinen urbains bien sombres. Un rendu que j’adore, comme chez Kengo Hanazawa, je pourrais passer des heures à étudier ses décors et leurs détails hyper réalistes. Hanazawa est trop sous-côté en France !

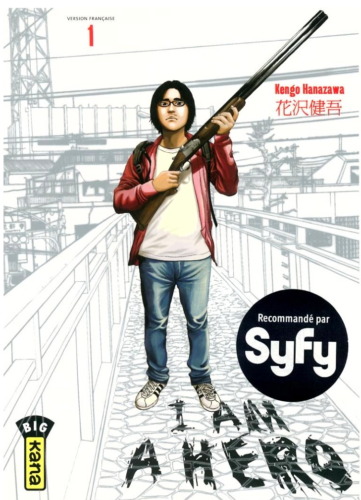
Les quartiers de Caen sont sans doute très éloignés de leur réalité et de leur cadre de vie. Est-ce que les artistes du Studio Atsu ont rapidement compris comme les représenter ?
Je leur ai envoyé des documents de référence et une fois passé une période de calage sur le premier chapitre, la collaboration a filé tout droit. Hormis une ou deux planches qui ont demandé des corrections, à chaque fois que je recevais les chapitres c’était fou, ils avaient réussi à sublimer mes idées, et à retranscrire les éclairages tels que je le voulais. Par moment, c’était drôle : ils n’avaient jamais dessiné le style street des jeunes en France, du coup je leur ai montré les hoodies, les doudounes sans manches, etc.
Chaque titre de chapitre fait référence à des sons comme Jusqu’ici tout va bien de Booba ou Cash Converter de Salif. Mais le rap a t-il été une influence au-delà de cet aspect ?
Caen, et au nord Hérouville-Saint-Clair, c’est une zone où évoluent d’importantes figures du hip-hop et clairement ça m’a influencé. Jérôme Lelièvre, un graffeur hyper connu sous le blaze de Sanetwo, faisait peindre tout le quartier quand j’étais jeune, c’est un pionnier du graffiti. Skread habitait à côté de chez moi, il est devenu le producteur d’Orelsan et il a décroché un Grammy Awards il y a quatre ans (Décernés à Los Angeles, les Grammy Awards sont considérés comme la plus haute récompense dans l’industrie du disque – Ndlr). On a aussi des breakeurs de haut niveau, Caen est vraiment une ville de puristes du hip-hop, j’ai grandi dans cette ambiance, avec le périphérique repeint de graffitis magnifiques, etc. Si le hip-hop est un arbre avec ses quatre disciplines (rap, deejaying, breakdance et graffiti), moi j’ai envie que le manga devienne une nouvelle branche (rires).

Le lancement de Diamond Little Boy
La sortie du premier tome a été précédée d’une collaboration avec la marque Schott NYC. Tu as pensé très tôt aux aspects plus business et promotion ?
Je veux faire de Diamond Little Boy une franchise et le perfecto Schott / Diamond Little Boy a été pensé dans ce sens. Toucher à la mode, ça se fait beaucoup au Japon : il y a déjà eu une collaboration entre l’équipe des Lakers de Los Angeles et One Piece, Hirohiko Araki a réalisé un book pour Gucci, etc. ça ne se fait pas encore en France, mais moi je suis très à l’affût de ce genre de plans.
Les stars du rap américain ont créé de multiples marques dans la mode, le luxe ou l’alcool. Est-ce qu’ils t’ont montré l’exemple en terme d’esprit d’entreprise ?
Oui, mais aussi un gars comme Orelsan, il a sa marque Avnier, il est dans le cinéma, etc. Et même sans parler de hip-hop, j’ai toujours été dans la bicrave et le business, c’est juste que j’ai changé de produit (rires) !
As-tu été conseillé par ton entourage en matière de business ?
Je suis entouré d’une équipe de gens de chez moi, qui sont impliqués dans le hip-hop. Skread, Ablaye et Orelsan, ce sont un peu mes grands frères, j’ai écouté leurs conseils.
Je me suis retrouvé dans une sorte de mercato pendant un an et demi : j’étais en discussion avec plusieurs éditeurs qui s’intéressaient à mon projet et on a fait monter les enchères. Surtout, j’ai cherché ce qui allait être le plus avantageux pour mon manga. Quels budgets ils proposaient pour la promotion, quelles structures allaient être mises à disposition ? Depuis des années, mes frérots me soutiennent, Orelsan a partagé mes posts sur Twitter, à l’époque où je publiais mes chapitres sur internet. Ils m’ont aussi accompagné et conseillé jusqu’à la signature du contrat d’édition.
Ma vie a changé, on me demande des selfies, j’ai de plus en plus de followers et quand ça arrive il vaut mieux avoir un entourage solide. Orelsan est une immense star mais quand tu traînes avec lui, tu vois qu’il est resté simple, il n’a pas la grosse tête. Et au-delà des questions de célébrité, de rester cool…il y a le business. On te propose des opportunités qui semblent incroyables, mais en fait non, il y a aussi des escrocs et des requins qui essayent de t’arnaquer. Avec les gens qui m’entourent, ça ne risque pas de m’arriver, ils sont trop dans la bienveillance.
À la sortie du manga, les médias ont reçu un dossier de presse, qui retrace ton parcours de façon très complète. Par contre, j’étais atterré de lire des formules comme « une plongée saisissante dans l’enfer des quartiers » ou « des explosions de violence aussi crues que réalistes ». C’est très cliché et réducteur, en plus le premier tome n’est pas si violent…
Tu t’en doutes, je n’ai pas écris le dossier de presse et la première version était bien pire que ça (rires). Disons que je ne vois pas mon histoire sous cet angle, mais que j’ai laissé la maison d’édition faire son travail.
C’est quand même problématique de retrouver encore et encore les mêmes stéréotypes à propos des quartiers périphériques et des gens qui y vivent.
« Dans l’enfer des quartiers », j’avoue que ça donne une image faussée. Mais quand les gens auront fini de lire le premier tome, pour moi c’est gagné, ils auront compris mon intention. Le quartier, c’est un décor, une atmosphère, mais ce n’est ni l’histoire ni un personnage. Sur mes planches, les immeubles bouchent l’horizon, l’histoire est comme enfermée et c’est une métaphore que je trouve importante. Je suis aussi très fier d’où je viens, on y trouve une vraie richesse culturelle et des valeurs que je trouve plus saines que dans pas mal d’autres endroits. Mais il faut aussi comprendre qu’on a eu besoin de présenter mon manga comme une histoire de mecs de quartier. Le public n’a plus le temps pour les nuances, tout va très vite. Il fallait aussi penser à la promotion à l’étranger, au Japon, pour que des gens qui ne connaissent pas du tout cette réalité comprennent directement d’où ça vient et de quoi on parle. Diamond Little Boy sera sans doute publié aux États-Unis et là aussi, on sera obligé d’en parler de cette manière. Mon taf à moi, c’est en partie de retranscrire dans cette histoire que le quartier ne se limite pas à ça.
Il y a d’ailleurs un passage, drôle et émouvant, sur ton oncle et le rockabilly. En plus ça vient casser cette idée préconçue qu’on n’écouterait que du rap dans les quartiers populaires.
Tout est vrai, même si il n’a jamais percé à un niveau de fou, mon oncle est un monstre en rockabilly ! Il a joué dans le plus gros festival du monde, à Las Vegas. On le suivait en tournée pendant les vacances, il m’a appris à jouer de la guitare et il a vraiment composé un morceau intitulé Diamond Little Boy. Tout ça fait partie de moi.


Au début du manga Victor se demande ce que signifie « devenir quelqu’un » et pourquoi il a autant besoin de reconnaissance. As-tu trouvé la réponse ?
Oui. Ça t’intéresse de la connaître ?
On va éviter les spoilers, mais oui…
La réponse viendra à la toute fin du manga. Disons que j’ai fini par comprendre qu’on vivait dans une société un peu malade et obsédée par la performance.
Pour savoir de quoi il retourne, chers lecteurs, à vous donc de découvrir Diamond Little Boy, aux éditions Vega ! Vous pouvez aussi suivre Victor Dermo sur les réseaux sociaux comme Instagram et Tik Tok.
Remerciements à Aurélie Lebrun et à Emmanuelle Verniquet (Games of Com) pour avoir organisé cette rencontre.