Éditions Ki-oon : rencontre avec les bureaux de Tokyo, depuis 10 ans au Japon !
Même si vous ne vous en souvenez sans doute pas, ou que vous ne l’avez jamais su, mais en 2015 les éditions Ki-oon lançaient un pari inédit : installer une antenne, leurs bureaux, au Japon. Déjà en pointe sur les créations françaises, avec son Tremplin Ki-oon, l’éditeur voulait étendre ses créations originales en puisant à la source : au Japon, et avec des auteurs japonais.
Cela n’a d’ailleurs rien de nouveau, puisque les éditions Ki-oon, il y a plus de 20 ans désormais, se lançait avec Element Line, leur premier titre qui était une création originale et non pas un rachat de droit à un éditeur japonais. Quelques temps plus tard, la jeune maison d’édition enfonçait le clou et se faisait connaître en publiant les titres de Tetsuya Tsutsui, que l’éditeur avait réussi à dénicher puis démarcher lui-même au Pays du Soleil Levant.
Dans la continuité donc, mais le passage d’un cap tout de même : revenons donc aujourd’hui sur cette aventure japonaise, qui fêtait ses 10 ans l’an dernier, avec Kim Bedenne, ancienne éditrice des éditions Pika et en charge de ce Ki-oon japonais.
Kim Bedenne : Kôdansha, Pika, puis Ki-oon

Journal du Japon : Bonjour Kim Bedenne et merci pour ton temps. Nous sommes là aujourd’hui pour évoquer les 10 ans du studio Ki-oon au Japon. Commençons par le début : un peu avant 2015, tu es éditrice aux éditions Pika, mais le Japon te manquait car tu y as travaillé assez longtemps, avant cet emploi chez Pika.
Kim Bedenne : Bonjour. Oui, en effet, 4 ans et demi de travail là-bas, après deux ans en tant qu’étudiante.
Puis tu as croisé le chemin de Ahmed Agne, directeur éditorial des éditions Ki-oon : qu’est-ce qui s’est passé, et comment tout a commencé pour Ki-oon Japon ?
Donc, en effet, j’ai travaillé au Japon, aux éditions Kôdansha, puis je suis revenue en France pour travailler chez Pika. Mais je me suis aperçue que ce retour en France était un peu du gâchis après tous les efforts entrepris pour apprendre le japonais et vivre au Japon donc j’ai essayé de retrouver une autre porte pour y retourner et acquérir un visa stable, etc..
Je connaissais déjà Ahmed et Cécile (NDLR : Cécile Pournin, co-fondatrice avec Ahmed Agne des éditions Ki-oon) depuis l’époque où je travaillais chez Kôdansha. En fait mon premier travail était la vente des droits internationaux. Je vendais les licences de manga de cet éditeur aux éditeurs de manga de la zone Europe de l’Ouest, essentiellement la France, l’Italie, l’Espagne et l’Allemagne.
J’avais pu rencontrer tous les éditeurs français de manga à cette période. Ahmed et Cécile n’étaient pas encore au niveau où ils en sont aujourd’hui avec Ki-oon mais ils étaient déjà sur une pente ascendante et nous avions échangé car ils s’intéressaient à certaines licences de chez Kôdansha.
Il savait qui j’étais, que je parlais japonais, et nous avions effectué, lors de mon retour en France des réunions de travail. Et, un jour, nous avions un diner ensemble avec des gens de l’édition du manga et à un moment j’ai dit : « oui, le Japon ça me manque, etc. »
Et c’est à ce moment-là qu’Ahmed m’a dit que Ki-oon avait dans l’idée d’ouvrir un bureau de représentation au Japon. Ils étaient en phase de recherche de représentant. J’ai donc décidé de poser ma candidature, j’ai réalisé un entretien, et j’ai été sélectionnée et après c’est allé assez vite.
J’ai pu aller au Japon dès la fin de mon préavis pour les éditions Pika, et dès octobre 2015 j’étais dans le bureau japonais, qui est situé à l’intérieur de la Chambre du Commerce et de l’Industrie française au Japon. Mon bureau est donc là-bas, et j’étais toute seule à l’époque. C’était mon adresse officielle et ce sont eux qui s’occupent de mon visa, de mes papiers… Je suis intégrée dans le système japonais de santé, de retraite et je suis payée comme les Japonais.
C’est comme ça qu’a commencé l’aventure ! (Rires)

D’accord. Tu as dit que tu as démarré seule : combien êtes-vous désormais ?
Nous sommes trois. Les deux personnes en plus sont en charge de trouver des auteurs et de développer des projets avec eux. Le bureau de Tokyo a de toute façon cette vocation de participer aux créations originales des éditions Ki-oon en trouvant des auteurs japonais. Pour les auteurs français, c’est Ahmed et Ki-oon France qui s’en charge.
Ensuite, en ce qui me concerne, je suis représentante. C’est-à-dire que je suis éditrice de manga mais, aussi, je vends des licences de manga des éditions Ki-oon auprès des éditeurs japonais. Je suis aussi en back-up pour la vente des licences, françaises ou japonaises, à l’international.
Enfin, dès qu’il y a besoin d’une mission de représentation auprès d’intervenants japonais, que ce soit pour Ki-oon, Mana-books ou Lumen, c’est moi qui m’y rends. Et puis nous réalisons aussi de la veille pour regarder ce qui sort en librairie et ce qui est mis en avant, et nous faisons un retour sur les dernières tendances. Mais, de toute façon, Ahmed est toujours très au taquet donc bien souvent il connait déjà tout ce que je lui dis ! (Rires)
Les auteurs que tu démarches au Japon, ceux avec lesquels un projet de manga va naître aux éditions Ki-oon en France… sont-ils ensuite publiés au Japon ?
Ce n’est pas une promesse que nous pouvons faire systématiquement aux auteurs. Tout dépend si nous arrivons à vendre la licence aux éditeurs japonais. C’est quelque chose que nous avons réussi à implanter de façon assez importante, grâce à un travail de terrain qu’il a fallu que je réalise, car ce n’est pas du tout dans la culture des Japonais d’acheter des licences de manga. C’est un des piliers de mon activité à Tokyo. Cela ne suffit pas de créer des licences manga en France, il faut aussi les vendre à l’international et forcément, quand il s’agit de manga, le Japon est un pays pas comme les autres.
Et qui n’est pas habitué à ce genre de démarche…
Complètement. Au début c’était surtout dur de trouver la bonne personne pour acheter des licences. Il faut bien comprendre que les maisons d’édition de manga ne disposait que des personnes pour vendre des licences à l’international, pas pour en acheter !
Du fait de mon travail chez Kôdansha, où je vendais des licences à l’international, je savais comment tout cela fonctionnais et j’avais déjà des contacts dans les maisons d’édition, j’avais des bonnes relations avec les services internationaux des diverses maisons d’édition japonaises. Donc au début, nous ne pouvions pas passer par la voie royale classique que prennent les auteurs japonais lorsqu’ils rentrent dans un magazine. Il s’agissait surtout de trouver une voie, d’en créer une même, avec beaucoup d’explications sur qui nous sommes, sur comment marche la licence, quels en sont les avantages et inconvénients, ce que l’on peut faire ou ne pas faire… À partir de là j’essayais de voir avec eux ce qui intéresserait les éditeurs japonais dans ce système-là.
Nous avons réussi, petit à petit, à trouver des personnes intéressées, directement chez les éditeurs japonais, et non pas dans le département des droits internationaux des maisons d’édition, qui eux ne font finalement que de la vente. Donc nous avons plutôt convaincu des éditeurs d’utiliser des œuvres originales de Ki-oon pour les mettre dans leur magazine, au même titre que leurs auteurs. Et, ça, nous l’avons fait avec les grands éditeurs : Shueisha, Kôdansha, Kadokawa, Akita Shoten… C’est-à-dire pas n’importe qui au Japon, tout de même. Cela nous a permis d’avoir une visibilité que nous n’avions pas avant, auprès des maisons d’édition japonaises.
Les lecteurs japonais, eux, ne nous connaissent pas vraiment pour autant, car le nom des éditions Ki-oon n’apparait pas dans les magazines, tout comme le nom de l’éditeur japonais n’apparait pas de manière visible quand un éditeur français publie un manga qui vient de ce dernier. Mais cela nous a permis d’avoir une carte de visite en quelque sorte, d’autant que nous avons connu quelques succès. Il y a eu Tsugumi Project qui s’est vendu à 400 000 exemplaires, Léviathan qui a été publié sur Jump+, qui est quand même une plateforme de manga très importante aujourd’hui, avec plus d’un million de vues pour les trois premiers chapitres par exemple. Donc nous avons pu acquérir une légitimité et il a été plus facile de négocier.
En effet. Tu nous as donc expliqué plusieurs missions du bureau de Tokyo mais, au départ, comment le projet t’a été présenté, quel en était la ligne directrice, la philosophie ?
Ahmed et Cécile, lorsqu’ils ont lancé les éditions Ki-oon en 2003-2004, ont commencé avec une création originale, Element Line, ce qui leur a permis de se faire une image de marque et une certaine crédibilité vis-à-vis des éditeurs japonais. C’est quelque chose qui a toujours été dans leur ADN, qu’ils ont continué de développer après, même s’ils étaient forcément très pris par tous leurs autres licences achetées ensuite auprès des éditeurs japonais. Je ne sais pas comment ils font d’ailleurs, pour réussir à lancer autant de titres en tant qu’éditeur tout en dirigeant la société ! (Rires)
Il faut bien expliquer que la création originale demande beaucoup de temps, beaucoup d’investissement et d’énergie donc ils ont rapidement pris conscience qu’une personne devait s’en occuper à plein temps. Ça c’était la première idée. Ensuite dans leur esprit cette personne devait être sur place, au Japon, pour aller chercher directement les auteurs japonais, être davantage en contact avec eux.
Avec ces deux éléments, la philosophie était de créer un catalogue de création originale qui nous appartienne sur le long terme et de façon ambitieuse… Pour que Ki-oon ait un catalogue pour moitié de création originale et pour moitié issu de l’achat de licences japonaises. C’est, comme je le disais, un projet sur le long terme. Nous n’y sommes pas encore ! (Rires)
L’avantage d’avoir ses propres créations permet de faire de l’audiovisuel, comme les Japonais, vendre les licences, lancer des goodies et faire plein de choses. En tant qu’éditeur de manga, cela nous semble assez naturel. Mais la facilité que confère l’achat de licence fait que beaucoup d’éditeurs ne se lancent pas, ou alors à la marge.
Il faut dire que ça demande beaucoup de travail…
Et beaucoup d’argent, aussi !
En plus, oui !
C’est un investissement énorme. Nous payons des gens pour qu’ils puissent vivre de leur création donc, forcément, ça ne peut pas être « pas cher ». On ne sait jamais si un titre va fonctionner ou pas. Nous avons eu de la chance de connaître beaucoup de réussites, parce que nous avons été prudents et que nous n’avons pas lésiné sur la promotion. Promotion qui, par conséquent, alourdit aussi la facture. Il faut donc avoir les épaules solides.
Tout ceci a été lancé à un moment où les éditions Ki-oon et plus globalement AC Media (NDLR : la maison mère des éditions Ki-oon, qui contient aussi les éditions Mana-Books et Lumen) avaient les épaules suffisamment solides et assez de poids sur le marché pour pouvoir investir sur ce genre de projet. On le sait moins chez les fans de manga mais les éditions Lumen fonctionnent aussi très bien.



Ils ont donc décidé de se lancer et de prendre ce risque. Tout le monde ne l’aurait pas pris mais on le doit aussi à l’indépendance d’esprit d’Ahmed et de Cécile, et de leur amour pour la création. C’était donc une grosse marque de confiance que de me choisir, je trouve.
Visiblement ça a payé, c’était un bon pari ! (Rires)
Trouver un mangaka au Japon… c’est facile ?
Sur ce lancement et ces débuts, est-ce que tu as des souvenirs, des anecdotes ?
Elle réfléchit…
Disons qu’au début, forcément, j’étais un peu nerveuse. J’étais toute seule au Japon et je ne savais pas vraiment comment commencer. Je pensais que ça allait être relativement simple parce que je me disais « oh il y a tellement de créateurs au Japon, ça va aller, je vais trouver ! ». En fait, non.
En réalité les très très bons qui veulent faire du manga à tout prix vont déjà de manière volontaire chez Shueisha ou Kôdansha pour proposer leurs travaux. Or nous ne voulions pas empiéter sur les plates-bandes de nos partenaires de business. Donc nous n’allions pas démarcher les auteurs déjà publiés chez eux. Il fallait trouver de nouveaux auteurs.
Ces nouveaux auteurs sont certes nombreux au Japon, mais ce n’est pas pour autant facile de trouver quelqu’un capable de réaliser dessin et scénario, et qui plus est de beaux dessins. Ensuite il faut aussi quelqu’un capable de développer une histoire sur le moyen ou le long terme, parce que nous n’allons pas commencer à les entraîner dans un magazine avec des histoires de 2 ou 3 chapitres, il faut qu’il puisse proposer un récit qui tient au moins sur 200 pages pour faire un volume. Bref, ce genre de profil ne court pas les rues finalement… Et puis il faut aller les chercher dans les conventions, ou sur internet.
Il n’y a pas de techniques miracles pour les trouver de toute façon !
C’est ça. Il a fallu prendre le temps, d’autant qu’ils ne nous envoyaient pas grand-chose au départ, car nous n’étions pas du tout connu. Donc je passais des heures et des heures sur internet à cliquer encore et encore et parfois tomber sur « oh non, encore du sexe ! Encore une femme en train de… » (Rires)
Enfin, voilà, ce fut compliqué. Quant aux conventions, c’était très sportif : je partais avec mon sac-à-dos, comme pour une journée de randonnée où j’achète plein de livres, des kilos même, et je me fais mon débriefing toute seule avec tous les fanzines achetés. Donc c’était un peu solitaire au début, surtout que je n’avais pas d’auteur. Pour trouver les premiers il m’a fallu environ 1 an, 1 an et demi, puis il a fallu les approcher. Ce qui n’était pas évident parce que je n’avais pas grand-chose à leur montrer à cette époque. Il y avait bien les mangas de Tetsuya Tsutsui mais ce n’était pas moi qui les avais faits.
De plus les succès de Prophecy, de Paper Boy et des autres titres commençaient à dater, un peu. Donc il fallait leur inspirer confiance alors que Ki-oon n’était pas du tout connu au Japon. Il fallait être persuasif et sympathique. J’ai même eu quelques autrices qui m’ont expliqué après coup qu’elle pensait que j’allais les arnaquer. Ça existe apparemment…
Oui on peut comprendre qu’ils se posent des questions « mais c’est qui cette française qui débarque comme ça ?! » (Rires)
Pour certains auteurs, il m’a fallu bien deux ans pour les persuader de travailler avec nous. J’ai du aller les voir, acheter leur fanzine, leur expliquer que nous étions vraiment séduits par ce qu’ils faisaient, que ça marcherait très bien en France… Tout a pris du temps.
De plus je n’avais personne avec moi pour me former. Ahmed avait lui plus d’expérience que moi en la matière, mais il était en France. Donc, même si nous faisions – et que nous faisons toujours – un point une fois par semaine, j’ai dû la développer par moi-même la façon de faire et la méthodologie, sans manuel, sans guide et surtout sans vraiment de certitude.
Donc les anecdotes, en fait, c’est : « il y a eu beaucoup de stress ! » (Rires)
Et aussi beaucoup de fail, forcément.
Du type ?
Par exemple je ne savais pas forcément comment parler aux auteurs japonais. J’ai tendance à être assez critique en tant que française. Je suis assez directe et je dis ce qui va mais aussi ce qui ne va pas.
Cela m’a valu un petit stalker. Une personne sur internet m’a envoyé son projet et je lui ai expliqué que ce serait compliqué pour notre marché parce qu’il y avait ceci et cela qui n’allaient pas. Et donc que j’étais désolé mais que nous ne le prendrions pas. Après ça j’ai eu chaque jour un message pas vraiment sympa, à chaque fois d’une adresse mail différente. Bon j’ai fini par aller à la police et ils l’ont trouvé : c’était quelqu’un qui vivait chez ses parents, dans la campagne japonaise. Et c’est d’ailleurs sa maman qui s’est excusée à sa place au téléphone. Et ça s’est fini comme ça cette aventure.
Ah oui quand même. On ne sait jamais sur qui on peut tomber !
Oui ça m’a appris à être prudente.
C’est normal !
De plus, au fil des ans, nous avons tout de même développé d’autres techniques. La première c’est un partenariat avec le magazine Afternoon des éditions Kôdansha. Le rédacteur en chef de ce magazine est très ouvert au marché français et au marché international, et comme j’avais travaillé chez Kôdansha, j’avais déjà eu l’occasion de le rencontrer plusieurs fois.

Et donc, désormais, nous avons accès aux projets qu’ils reçoivent pour leur concours des Quatre saisons et nous pouvons voir les projets qui n’ont pas été retenus pour le magazine, pour voir s’il y a des choses qui peuvent nous intéresser.
Le second point, c’est que nous nous sommes inscrits sur une plateforme, qui se nomme Days Neo, qui a été créé par les éditions Kôdansha mais qui accueille de nombreux éditeurs et auteurs, pas uniquement de chez Kôdansha, pour faire du matching entre les deux métiers. Les mangakas y ajoutent leurs œuvres, et les éditeurs peuvent faire des commentaires ou se porter candidat pour devenir l’éditeur d’un titre. Ensuite c’est l’auteur qui décide qui il rencontre pour aller plus loin et publier son manga.
C’est pas mal en effet, ça aide !
Compléter, innover… et ne pas concurrencer
Je reviens un peu sur les éditeurs japonais. Tu expliquais que vous ne vouliez pas mettre à mal vos relations avec eux en démarchant de nouveaux auteurs pour vos créations originales. Comment ça s’est passé ?
Nous avons essayé de leur montrer que nous n’étions pas des concurrents directs, de ne pas les mettre mal à l’aise pour continuer à travailler avec eux. Nous avons toujours besoin de leur acheter des licences. Mais pour eux, les auteurs, c’est leur trésor.
Donc nous sommes allés les voir dès le départ, pour leur expliquer. Bien évidemment je faisais très attention à la façon de présenter les choses pour préserver nos relations : je les connais depuis longtemps, j’étais déjà en contact avec eux et je travaillais avec eux avant Pika, donc nous avons toujours eu un bon contact. J’ai donc pu leur expliquer notre démarche : « voici ce que nous allons faire dans nos bureaux de Tokyo ; nous allons prendre uniquement des auteurs débutants et essayer de développer des créations pour le marché français. » Finalement, ils se sont montrés très intéressés. Pour eux, il s’agissait d’auteurs qu’ils n’auraient pas forcément recrutés donc chacun pouvait faire sa vie sans que l’on se gêne.
De plus, ils étaient curieux de voir ce que cela pourrait donner comme type d’histoire. Le marché japonais est certes énorme, mais ils sont un peu en recherche de nouveautés et des nouvelles tendances. Cela leur permet aussi de mieux comprendre les marchés internationaux, car ils voient chaque année les chiffres des licences de manga à l’international qui augmentent, encore et encore.
Mais comme ils sont très concentrés sur leur marché intérieur, ils ne savent pas toujours comment appréhender la construction des succès à l’étranger. Donc notre projet a éveillé leur intérêt et leur curiosité, pour savoir ce que nous ferions avec des auteurs japonais pour obtenir des réussites sur le marché français. Ils ont été très attentifs lorsque je suis venu leur présenter nos créations et leur proposer d’acheter nos licences. Ça ne marchait pas à tous les coups, bien sûr, mais ils se montraient très réceptifs et assez ouvert sur ce genre d’initiative.
Justement, comment se porte le marché japonais et sait-il se montrer toujours aussi créatif ?
Il y a plusieurs choses à dire là-dessus.
Tout d’abord je pense qu’il n’y a jamais eu autant d’auteurs publiés, parce qu’il n’y a jamais eu autant de magazines grâce au numérique. Le numérique aujourd’hui, en termes de ventes, c’est 60 à 70% des ventes au Japon, sachant qu’ils vendent le magazine numérique au même prix que le papier.
Ensuite le Japon est-il toujours aussi créatif ? Oui le Japon a toujours été très créatif. Ils ont développé des systèmes éditoriaux très bien rôdés pour prendre les meilleurs, en les faisant passer via des comités éditoriaux, pour savoir repérer quand ça ne marche pas pour arrêter et faire autre chose… Tout ça leur permet de se renouveler.
Après, ils ont tout de même tendance à tourner en boucle sur des genres en particulier. Mais c’est sans doute l’un des biais du numérique et de la puissance des algorithmes. Ils vont donc se retrouver à produire énormément de titres sur certaines tendances comme le Isekai, la revanche de la vilaine… qui sont des genres assez simples à créer en plus, ou alors adaptés directement des light novel.
En ce moment il y en a vraiment beaucoup car il est facile d’entrainer des lecteurs dans des boucles algorithmiques et de s’assurer des bases de revenus pour leur magazine. Ils sont, sans doute, devenus un peu dépendant à ça et ils mettent beaucoup d’énergie pour avoir ce minimum vital plutôt que de mettre ce temps et cette énergie dans des œuvres plus complexes et plus riches. Certes ce sont des initiatives plus risquées mais elles peuvent aussi accoucher de titres plus intéressants, plus marquants et au final qui vont devenir les hits et les best-sellers de demain, et qui vont en partie renouveler le genre.
Le numérique permet de créer des magazines à foison mais le nombre d’éditeurs n’augmente pas pour autant donc on se retrouve avec moins d’éditeurs par magazine et il est plus difficile de se concentrer sur le suivi des auteurs, encore plus quand il s’agit de nouveaux auteurs. Mais c’est quelque part un avantage pour nous. Ces éditeurs veulent remplir leur magazine et lorsque l’on arrive et qu’on leur offre des licences, ça les arrange puisque tout est déjà fait. Ils n’ont même pas de traduction à faire, c’est déjà en japonais à l’origine !
Donc c’est vrai que c’est une facilité pour eux…
Cela dit le numérique, au début ça les a un peu effrayé, notamment lorsqu’ils ont vu arriver la vague du webtoon. Mais désormais au Japon cette vague est un peu retombée puisque c’était un système très formaté et très marketé donc on finit par avoir des œuvres qui se ressemblent et les gens finissent par se lasser ou en tout cas par rechercher autre chose.
À côté de ça on pensait que l’Isekai allait lui aussi retomber mais ce n’est pas encore le cas. Je pense que c’est lié en partie au niveau de fatigue de la société japonaise qui a toujours besoin de souffler, de s’évader un peu sans trop réfléchir, avec une lecture reposante dans les transports par exemple. À un moment c’est d’ailleurs ce qu’offrait le webtoon, donc ça a aussi aidé à son essor.
Mais ce qui fait un vrai hit ce n’est pas seulement ça évidemment. C’est le mélange d’ingrédients et de codes que l’on connait avec une dose d’originalité, et ça on ne peut pas le faire avec des œuvres trop formatées… ou du moins autant qu’avec des genres aussi formatées que le webtoon ou l’isekai. C’est quelque chose qu’arrive à faire le Shônen Jump, mais c’est parce qu’ils vont essayer énormément de choses avant de se décider à mettre une série sous les projecteurs. Le revers de la médaille c’est qu’une nouvelle série chez Shueisha ça peut très vite se finir.
Chez la maison Kôdansha, c’est difficile depuis la fin de l’Attaque des Titans et de Tokyo Revengers mais ils ont beaucoup misé sur la comédie romantique, qui est devenue une de leur marque de fabrique. Néanmoins, si la comédie romantique peut plaire au grand nombre, c’est rarement avec ce genre de thématique que l’on fait des supers hits.
C’est aussi pour cela que nous pouvons les intéresser, et qu’ils essaient de lancer des initiatives vers l’étranger. Shueisha l’a fait avec Manga Plus, Kôdansha l’a fait avec K Manga. Kôdansha a aussi développé des concours de manga qui sont voués à être développés à l’étranger… Bon par contre lorsque l’on dit « à l’étranger », c’est d’abord aux États-Unis dans leur esprit.
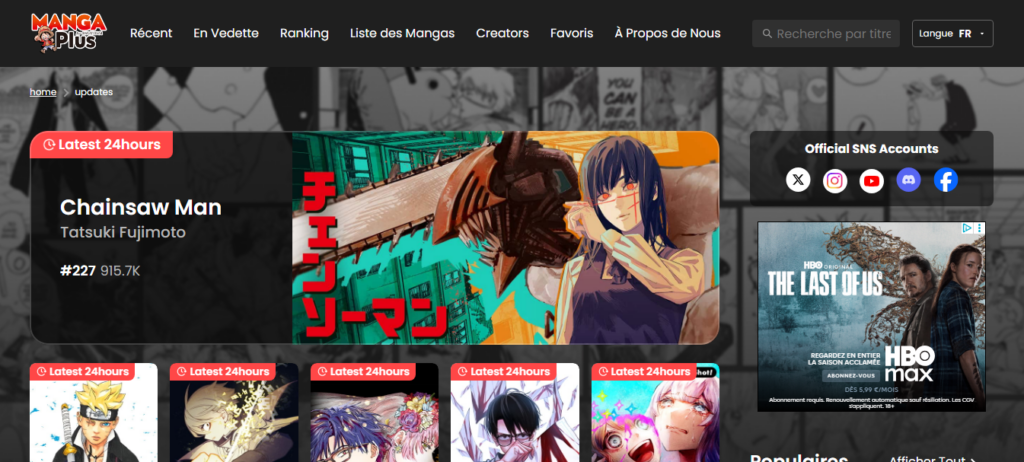
Même si des mangas il y en a partout maintenant à travers la planète…
Disons que les lignes bougent un peu mais après ça reste compliqué puisqu’au sein des comités éditoriaux ce ne sont que des Japonais, qui ont rarement vécu ailleurs qu’au Japon. Il est donc difficile de leur demander de s’adapter à des cultures qu’ils ne connaissent pas du tout et dans des pays où ils n’ont jamais mis les pieds. Et c’est la même chose pour les auteurs japonais.
D’ailleurs c’est un point important dans mon dialogue avec eux. Je ne leur demande jamais d’écrire pour le marché français. Je leur demande : « dites-moi ce que vous voulez dessiner, et si ça peut fonctionner pour notre marché français, on y va. Sinon on n’y va pas… mais n’essayez pas de penser aux Français ou n’essayez pas de faire quelque chose pour leur plaire. Les Français et les Japonais apprécient les mêmes choses, à quelques exceptions près, donc allez-y, donnez-moi plutôt vos idées. »
On retrouve cette problématique dans la J-music lorsqu’elle veut sortir de ses frontières : on préfère qu’elle garde une certaine authenticité plutôt que de changer pour essayer de nous plaire. Parce que sinon je n’ai pas besoin d’écouter de la musique japonaise, je me contente d’allumer la radio et j’aurais largement ce qu’il me faut en musique occidentale.
Je pense que ça dépasse le monde de l’édition justement : globalement les Japonais ont souvent du mal à comprendre ce que nous apprécions tant dans leur culture.
C’est une grande interrogation pour eux en effet !
Donc je pense qu’il ne faut pas les pousser à essayer de faire quelque chose pour nous mais de les laisser faire ce qu’ils ont envie.
Ils ont assez d’imagination pour créer des œuvres marquantes sans avoir à se préoccuper de tout ça.
En plus je pense qu’il y a lieu d’être optimiste puisqu’il y a de plus en plus de portes ouvertes aux femmes, aux autrices, ce qui va de pair avec une augmentation massive du nombre de lectrices ces dernières années. Donc je pense que ça peut être une vraie source de renouvellement, un atout pour les œuvres à venir, y compris pour les shônen.
Quand est arrivé Tokyo Revengers, on a pu observer une très grande popularité chez le lectorat féminin. Encore plus au moment du film live, on a bien vu que c’était des femmes qui remplissaient les cinémas !
C’est une bonne nouvelle je trouve, en effet. Après il faut aussi que les comités éditoriaux se féminisent.
C’est le cas ou pas ?
Pour l’instant ça se féminise dans les comité seinen, un peu, mais pas vraiment dans les édito shônen. Dans les shôjos les éditos étaient déjà très féminisés évidemment, dans une logique un peu « par des femmes pour des femmes. » (Rires)
Pour les shônen disons qu’ils acceptent désormais plus les autrices mais pour ce qui est des éditeurs il y a encore du travail. Mais ça va venir… j’espère !
Tu parlais tout à l’heure des questions que se posent les auteurs et les éditeurs sur l’international. Est-ce que ce marché est devenu un objectif pour les auteurs et les éditeurs ou pas du tout ?
Les mangakas en général sont plus conscients du succès du média manga à l’international. Ils ont vu débarquer, à travers les réseaux sociaux notamment, les commentaires des fans étrangers.
Je pense d’ailleurs que le lancement de Manga + ou de K Manga par les éditions Shueisha et Kôdansha, c’était aussi une façon de faire plaisir aux auteurs en proposant leurs œuvres en anglais et au plus grand nombre.
Ceci étant dit, les mangakas dessinent d’abord pour le marché japonais. D’habitude on en rencontre très peu dont l’objectif premier est de lancer un manga pour le marché américain ou européen.
Maintenant si je parle de mes auteurs je dirai que c’est du 50/50. Certains d’entre eux sont des amateurs de bande-dessinée par exemple. C’est le cas de Shiro Kuroi, l’auteur de Leviathan, de Cocoro Hirai, l’autrice de Les temps retrouvés, qui a fait tout en couleur… Ippatsu de Tsugumi Project avait travaillé pour Jirô Taniguchi qui lui avait fait découvrir la BD franco-belge. Au départ, d’ailleurs, l’idée d’Ippatsu était de travailler pour un éditeur français. C’était son objectif dès le départ. C’est pour ça que son héros s’appelle Léon et qu’il est français.


Donc il existe en effet des auteurs qui se disent que la France c’est le pays de l’Art, de la Bande dessinée, mais la plupart ne connaissent pas vraiment notre pays et n’y sont jamais allés. Ce qui les intéresse surtout c’est de pouvoir faire une œuvre qui leur plait, avec une certaine liberté de ton. Je travaille comme les éditeurs japonais avec eux : je vérifie les storyboard, les pages finalisées… Je suis très présente dans le processus de création. Mais nous n’avons pas à diriger le scénario et l’œuvre en fonction de l’avis des lecteurs, parce qu’au début il n’y en a pas et que nous ne sommes pas dans un magazine. Bon cela dit maintenant il y a les avis de Manga Nova, mais ils arrivent tout de même bien après le travail effectué : on lance un titre sur Manga Nova lorsqu’un volume, un volume et demi sont prêts.
Donc le récit est déjà bien engagé.
Ça permet d’avoir des œuvres qui correspondent finalement bien aux auteurs, à chaque fois. Et ça, ils apprécient… Tout comme une certaine souplesse dans les plannings. Nous avons des plannings avec des dates butoirs et une certaine rigueur : c’est important et nécessaire de se caler sur un rythme et d’arriver à le suivre, sachant que nous essayons de suivre celui des magazines mensuels.
Mais nous pouvons nous adapter. En fonction d’obligations familiales par exemple : Switch Family est réalisé par Marie Sasano et son mari, Ryôsuke Tanno. Ils ont un fils donc généralement durant les vacances scolaires c’est compliqué pour eux, ils ne peuvent pas avancer. Il y a aussi des auteurs qui ont un travail en même temps que leur manga. L’auteur de Léviathan avait un travail à temps plein à côté au début, il réalisait son manga sur son temps libre. Nous essayons donc d’être assez souples quand nous sommes attachés au projet, et ça aussi les auteurs apprécient.


Certains auteurs ont eu des mauvaises expériences passées avec des éditeurs japonais donc ça leur permet de reprendre la voie du manga professionnel, mais sous une autre forme.
Plus souple, avec moins de pression…
Oui, il y a de ça. Mais aussi l’impression d’être écouté et entendu. De toute façon, quoi qu’il arrive, que ce soit au Japon ou ailleurs, c’est toujours un petit miracle une rencontre entre un auteur et un éditeur qui ont envie de faire la même chose, d’aller dans la même direction.
Quand ils sentent qu’il y a une étincelle, ils acceptent et on se lance. Mais ce n’est pas tout le monde, l’alchimie ne se crée pas à chaque fois, ce n’est pas un taux de réussite de 100%.
10 ans au Japon : le chemin parcouru
On arrive à la fin de cette interview… Vous fêtez donc vos 10 ans. Bravo d’avoir tenu une décennie déjà ! (Rires)
Quel bilan faites-vous du chemin parcouru ?
10 ans, c’est passé vite…
En fait il faut environ 3 ans d’engagement par projet, donc en 10 ans, on a l’impression de ne pas avoir fait grand-chose. Mais, quand je prends du recul, je vois que nous avons un beau catalogue. En comptant les anciens titres nous en sommes à 30-40 licences désormais. Nous avons vendu les trois quarts à l’étranger et les deux tiers au Japon, et ça personne n’avait réussi à le faire.
Je suis assez fière pour le Japon, parce que c’est pour cela que j’ai été engagée : pour ma connaissance des réseaux de l’édition japonaise, dans la vente de licences manga et de la façon d’interagir avec les Japonais. Donc je suis contente d’avoir pu mettre ces compétences au service de ce projet et d’avoir réussi à franchir toutes ces étapes.
Maintenant ce que nous voulons faire c’est d’enclencher les adaptations audiovisuelles de nos mangas, en anime, en film, etc. pour reprendre le modèle des éditeurs japonais. Ça, quand nous aurons réussi à le faire, j’aurai vraiment l’impression d’avoir passé un gros, très gros, cap.
Après les premières sorties ça a été un moment marquant aussi. À chaque nouveau titre qui sort c’est fort en émotion, et c’est aussi plein de sentiments contradictoires : « ah c’est trop bien ! » « mais est-ce que ça va se vendre ? » « S’il vous plait achetez ce mangaaaa ! »
Cela prend tellement d’énergie, tellement de temps, avec des auteurs qui donnent tout pour rendre leur titre le meilleur possible. On peut évidemment être critique sur une œuvre mais il ne faut pas oublier qu’il y a un humain derrière. Je pense que 80% de mon travail c’est d’encourager les auteurs, parce qu’ils se posent plein de questions, qu’ils n’ont pas confiance en eux, qu’ils n’arrivent pas à voir si leur travail rencontrera un public ou pas. Donc il faut que nous les rassurions, même si la plupart d’entre eux ont juste de l’or entre les doigts !
Mais, bien souvent, comme ce sont des artistes, ils ont besoin de s’exprimer à travers leurs créations parce que les autres moyens de communication ne sont pas vraiment simples ni évidents pour eux. Donc dans le monde actuel, avoir de la reconnaissance à travers les ventes de leur manga c’est vraiment quelque chose d’hyper important pour eux, ça les touche en plein cœur.
Ce sont donc des aventures humaines à chaque fois. Donc, quand cela ne marche pas, je suis forcément hyper triste… Mais j’essaie de ne pas le montrer et de ne pas stresser les auteurs, surtout pas. Le but c’est qu’ils puissent continuer leur récit jusqu’au bout et que, même si ça n’a pas marché en France, nous pouvons vendre la licence et le manga peut avoir une autre vie ailleurs.
Et quand ça réussit, c’est génial ! C’est champagne ! (Rires)
Justement quel est le titre qui a le mieux marché jusqu’à présent ?
Tout dépend du critère de réussite que l’on choisit.
En termes de ventes pures, en France et à l’étranger, Beyond the clouds a été un énorme succès. L’autrice est venue en France à Japan Expo d’ailleurs, c’était assez chouette.
Si l’on se focalise sur les ventes au Japon, c’est Tsugumi Project qui a le mieux fonctionné, avec lequel nous avons pu réussir à faire un gros carton chez Kôdansha. Ils étaient très contents.
Enfin si parle de réussite en France, à l’étranger et au Japon, Léviathan a fait un beau carton. Nous avons pas mal de réussites en fait. Je pourrais aussi citer l’Eden des sorcières, publié au Japon dans un magazine de grande qualité qu’est Harta (le magazine de Bride Stories, Isabella Bird, et d’autres très bons titres) et qui a rencontré pas mal de succès en France. Sans oublier, même si là je n’y suis pour rien, les titres de Tetsuya Tsutsui qui sont emblématiques ou plus récemment Dark Soul avec le gros travail de Mana Books qui a réussi à le sortir en France et au Japon.
Après de toute façon, je suis une grande fan de tous les titres sur lesquels j’ai pu publier, il n’y en a aucun que j’enlèverai du catalogue. Je pense que, à chaque fois, nous publions des bons mangas. Je pense qu’en interne c’est une belle collaboration entre la France et le Japon que ce soit pour la fabrication, le marketing, la communication… Tout le monde est à chaque fois embarqué, ça fait vraiment plaisir de voir mes collègues motivés par les titres que je leur propose. Ce sont des beaux compliments en quelque sorte… Car moi aussi, comme mes auteurs, j’ai besoin d’être encouragée ! (Rires)
En plus maintenant nous sommes trois. Camille Parat, qui est avec moi depuis deux ans et demi, voit ses projets bien évoluer et ils pourront sortir prochainement. Nous avons un deuxième éditeur qui vient d’arriver et que je suis en train de former mais qui connaît bien le manga aussi. Donc nous sommes tous à fond et on ne lâche rien. L’histoire ne fait que commencer !
Parfaite façon de finir cet entretien. Merci beaucoup !
Le plaisir est pour moi. C’est toujours un plaisir de faire la promotion de mes titres ! (Rires)
On souhaite donc dix nouvelles années aussi riches que les précédentes, en oeuvre comme en aventures ! Pour suivre l’actualité des bureaux de Tokyo et de leurs titres, on vous conseille leur compte Instagram, de suivre Kim Bedenne sur X ou de jeter un œil à leur Linktree.
Questions posées par Tatiana Chedebois, à Japan Expo 2025.
Remerciements à Kim Bedene pour son temps et sa bonne humeur, et à Victoire de Montalivet pour la mise en place de cette interview.










