Paroles de Trad’ : Black Studio, la traduction en tous genres !
Ce sont eux qui remplissent les bulles de vos mangas préférés : les traducteurs. Souvent dans l’ombre, ils sont pourtant des acteurs indispensables du manga et ont un impact direct sur nos lectures. Journal du Japon décide donc de leur ouvrir une rubrique trimestrielle dans ses colonnes, pour leur tendre le micro : Paroles de Trad’, une interview d’un ou d’une traductrice pour parler de son métier, son parcours, son rapport à la langue et au Japon, les mangas qu’il traduit, quelques anecdotes, etc. Il y a toujours beaucoup à dire !
Pour ce premier numéro, ce n’est pas un mais deux traductrices issues de la société Black Studio « le premier studio dont l’originalité est de regrouper traducteurs, adaptateurs & lettreurs dans un travail conjugué pour une meilleure adaptation du Manga et de la Bande Dessinée en France. » Anaïs KOECHLIN, traductrice et co-fondatrice du studio et sa binôme Claire OLIVIER ont donc répondu à nos questions pour une interview des plus enrichissantes.
Les chemins de la traduction…
Journal du Japon : Avant de parler de traduction, commençons par vous mesdemoiselles… Anaïs et Claire quels sont vos parcours de traductrice ?De quand date votre rencontre avec le manga ?
Claire : Mon premier manga remonte à l’époque du collège, avec Dragon Ball. Je n’avais pas accroché à l’anime, à cause des longueurs et des fillers, c’est le manga qui m’a fait aimer cette série. Je pense que je le connais quasiment par cœur, tellement je l’ai lu et relu.
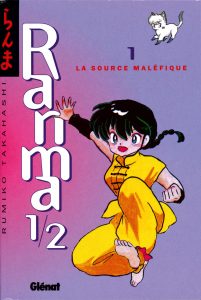 J’ai enchaîné avec Ranma (je suis une grande fan de cette série qui mêle un peu tout : humour, romance, combats, tradition), Evangelion (j’adorais le côté métaphysique/psychologique), Slam Dunk (je n’étais pas particulièrement fan de basket, mais j’ai carrément accroché à l’histoire), GTO, Nana : voilà les principaux titres qui m’ont marquée.
J’ai enchaîné avec Ranma (je suis une grande fan de cette série qui mêle un peu tout : humour, romance, combats, tradition), Evangelion (j’adorais le côté métaphysique/psychologique), Slam Dunk (je n’étais pas particulièrement fan de basket, mais j’ai carrément accroché à l’histoire), GTO, Nana : voilà les principaux titres qui m’ont marquée.
Anaïs : Je crois que mon premier manga a été Gon. À l’époque, je ne savais même pas ce qu’était un manga, mais je dévorais tout ce que je trouvais dans la bibliothèque où travaillait ma mère. En réalité, j’ai grandi loin des mangas et des animés, jusqu’à ma rencontre avec celui qui allait être mon mari et qui était passionné par toute cette culture depuis des années. Je me souviens m’être dit que tout un monde s’ouvrait à moi. Il m’a fait découvrir des dizaines de titres et je les ai dévorés. Il me semble que la première série était Kenshin. Depuis, je l’ai relue de nombreuses fois, en japonais et en français. Et puis, j’ai découvert URASAWA… La claque ! Ensuite, sont arrivés Tezuka et Taiyô MATSUMOTO…
J’ai l’impression d’en oublier plein… Takehiko INOUE, KISHIRO…
Entre aimer lire des mangas, apprendre la langue et enfin décider de devenir traducteur de manga… il y a tout un chemin. Quel a été le déclic pour vous, à quel moment vous avez décidé d’en faire votre métier ?
C : J’ai commencé à apprendre le japonais en autodidacte en fin de lycée/début de fac pour pouvoir comprendre à la source les dramas/animes que je regardais en VO. Mais il y a un manga qui a vraiment déclenché mon envie de m’y mettre sérieusement : Samurai Deeper Kyo. Je faisais partie d’un forum dédié à ce manga et j’ai fait du scantrad. C’est à ce moment-là que j’ai eu le déclic et que je me suis dit que j’en ferais bien mon métier.
Je me suis alors inscrite à l’INALCO, d’où je suis sortie diplômée d’un master de japonais, spécialité linguistique. J’ai également étudié pendant un an et demi à l’université des langues étrangères de Tokyo.
Quand j’ai eu mon diplôme, je n’ai pas tout de suite commencé à travailler comme traductrice, j’ai d’abord donné des cours de japonais à domicile, puis j’ai eu l’opportunité de rentrer dans le milieu grâce à Anaïs qui m’a recommandée auprès de Kazé.
A : J’ai commencé à apprendre le japonais avec Kiyoshi, un oncle par alliance qui est japonais. Il m’a enseigné les bases pendant que je faisais mes études de sciences du langage. Au début, ça n’avait rien à voir avec les mangas, j’étais juste passionnée par les langues. Je parle anglais depuis toute petite avec mon père et je voulais même apprendre le russe.
Quand j’ai terminé ma maîtrise de linguistique, j’ai voulu aller plus loin. Je me suis inscrite à l’INALCO. Pendant tout ce temps, je n’imaginais pas du tout devenir traductrice, j’avais même déjà un autre métier, professeur de français langue étrangère. Aurélien, qui fait aujourd’hui partie du studio, m’a appris qu’Asuka (avant de devenir Kazé manga) recherchait des traducteurs. Je me suis proposée, j’ai fait un essai et j’ai commencé à traduire des shôjos. Ensuite, je suis partie vivre au Japon, je prévoyais d’y enseigner le français, tout en continuant les traductions. Elles se sont enchaînées et un jour, alors que je parlais de ma carrière de prof de FLE, un proche m’a dit « mais, tu n’es pas déjà traductrice ? ». Ça a fait Tilt. Ben oui, je suis traductrice, c’est vrai ! Tout à coup, c’était évident. Bref, le déclic est arrivé alors que j’étais déjà dedans et je ne l’avais pas du tout prévu.
Anaïs : j’ai lu que tu as commencé à traduire des mangas en 2009, c’était quoi ta première traduction et quel souvenir en gardes-tu ?
 A : Ma première traduction, c’était pour le shôjo Private Prince de Maki ENJÔJI, ça fait presque 8 ans, maintenant. Ahem, ça ne nous rajeunit pas, cette affaire… L’histoire était sympa et le style de Maki ENJÔJI aussi, donc je me suis beaucoup amusée. Il fallait tout apprendre sur ce premier boulot et j’ai été très bien guidée par Asuka. Pour l’anecdote, à l’époque, je traduisais tout sur papier, je noircissais des feuilles et des feuilles que je retapais ensuite à l’ordinateur. Ça me prenait un temps fou, mais j’avais du mal à trouver l’inspiration devant l’écran. J’avais besoin de passer par le crayon de papier et la gomme.
A : Ma première traduction, c’était pour le shôjo Private Prince de Maki ENJÔJI, ça fait presque 8 ans, maintenant. Ahem, ça ne nous rajeunit pas, cette affaire… L’histoire était sympa et le style de Maki ENJÔJI aussi, donc je me suis beaucoup amusée. Il fallait tout apprendre sur ce premier boulot et j’ai été très bien guidée par Asuka. Pour l’anecdote, à l’époque, je traduisais tout sur papier, je noircissais des feuilles et des feuilles que je retapais ensuite à l’ordinateur. Ça me prenait un temps fou, mais j’avais du mal à trouver l’inspiration devant l’écran. J’avais besoin de passer par le crayon de papier et la gomme.
Ensuite Claire, toi aussi, racontes-nous ta première trad’ !
C : Le premier manga que j’ai traduit professionnellement est Egoistic Blue. C’est un yaoi, en one-shot. Kazé avait besoin de quelqu’un pour ce titre et Anaïs, qui travaillait déjà pour eux depuis quelques années, m’a recommandée. J’ai un peu hésité au début, parce que je ne suis pas amatrice de ce genre, mais au final, c’était un yaoi soft, proche d’un shôjo, donc ça s’est très bien passé. J’étais surtout contente d’avoir enfin un premier titre.
Qu’est-ce que chacune apprécie dans le travail de l’autre ?
C : Ce que j’apprécie dans le travail d’Anaïs, c’est son style d’écriture et son imagination, notamment pour les jeux de mots. Quand je suis en panne d’inspiration pour trouver une formulation qui claque, je lui demande et, en un rien de temps, elle me sort 4 ou 5 propositions !
A : Ce que j’apprécie chez Claire, c’est sa spontanéité, son intuition, son naturel, alors que moi, je suis toujours trop dans l’analyse et le décorticage excessif. Elle me recadre sur l’essentiel. Elle a une vision des choses naturelle. Quand je pars dans une analyse compliquée, elle va me dire : « Mais non, il est juste en colère, ton personnage »… On se complète bien, en fait, ça crée un super équilibre.
Comment traduire ?
Passons au métier lui-même maintenant… Comment travaillez-vous pour la traduction d’un manga ?
C : Nous recevons deux exemplaires de la part de l’éditeur. Un que nous « indexons » (c’est-à-dire que nous numérotons les bulles pour faire une correspondance avec la traduction dans le fichier Word) et que nous renvoyons à l’éditeur, et un que nous gardons et qui peut nous être utile en cas de questions/corrections ultérieures.
Est-ce que tout le monde s’y prend pareil d’ailleurs, est-ce qu’il y a différentes façon de faire ?
C : Tout le monde a sa façon de faire. Moi, je procède en 4 étapes :
1- Je fais tout d’abord un premier jet « rapide » de tout le volume. Je surligne les passages sur lesquels j’ai des doutes, mais je ne m’attarde pas trop dessus. Je préfère avoir un aperçu global du volume entier : le japonais étant une langue à contexte, on peut se retrouver bloqué sur certains passages par manque de visibilité, la solution se trouvant souvent dans la compréhension globale de l’histoire.
2- Je fais une première relecture avec le japonais, axée sur la vérification du sens et la résolution des doutes que j’ai pu avoir lors du premier jet. Quand je bloque vraiment sur un point, je questionne des amis japonais ou Anaïs.
3- Je fais une seconde relecture avec le japonais, axée sur le style et l’orthographe. Là, mon but est que la lecture en français soit la plus naturelle possible.
4- Enfin, une dernière relecture, uniquement du français, pour faire un ultime check global.
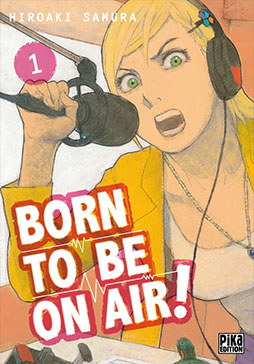 A : Je fonctionne assez différemment, mon premier jet est quasi définitif. J’ai du mal à passer à la bulle suivante tant que je ne suis pas entièrement satisfaite, sous tous les aspects. À la fin, je relis tout pour assurer l’harmonie générale avec une vision plus globale et je retravaille certains passages et leur enchaînement. Parfois, il faut revoir la dynamique des effets humoristiques ou des moments émouvants, par exemple. Pour Born to Be on Air, il m’est arrivé de remodeler complètement certaines blagues, parce qu’avec du recul, ça ne donnait pas l’effet escompté. Une autre étape qui est très importante, c’est la relecture après le lettrage, quand le texte n’est plus un long fichier Word sans images et lorsque les répliques sont dans les bulles. Là, je fais pas mal de propositions de modifications que j’envoie à l’éditeur. Souvent, le passage en image change la perception du texte. L’impact est différent, il faut réajuster.
A : Je fonctionne assez différemment, mon premier jet est quasi définitif. J’ai du mal à passer à la bulle suivante tant que je ne suis pas entièrement satisfaite, sous tous les aspects. À la fin, je relis tout pour assurer l’harmonie générale avec une vision plus globale et je retravaille certains passages et leur enchaînement. Parfois, il faut revoir la dynamique des effets humoristiques ou des moments émouvants, par exemple. Pour Born to Be on Air, il m’est arrivé de remodeler complètement certaines blagues, parce qu’avec du recul, ça ne donnait pas l’effet escompté. Une autre étape qui est très importante, c’est la relecture après le lettrage, quand le texte n’est plus un long fichier Word sans images et lorsque les répliques sont dans les bulles. Là, je fais pas mal de propositions de modifications que j’envoie à l’éditeur. Souvent, le passage en image change la perception du texte. L’impact est différent, il faut réajuster.
Est-ce qu’il y a un lien ou un contact avec le ou la mangaka, parfois ?
A : C’est vraiment rare. Il n’y que pour la trilogie À nous deux, Paris de J.P. Nishi que j’ai rencontré le mangaka. Il est venu voir notre studio et on a visité le sien. J’ai pu échanger avec lui pendant la traduction des volumes, c’était génial. On a beaucoup sympathisé et on le voit dès qu’on va au Japon, mais c’est une situation exceptionnelle.
Anaïs je vois que tu fais aussi de la traduction de jeu vidéo et j’ai vu que Black Studio fais aussi de la traduction d’anime : en quoi le travail sur les mangas se distingue des deux autres formats ?
A : Dès qu’on change de format, c’est très différent. C’est aussi ça qui est génial dans ce métier, la façon de travailler et les méthodes changent, on ne s’ennuie jamais. Les contraintes ne sont pas du tout les mêmes avec le jeu vidéo. On doit souvent respecter des limites de longueur, au caractère près, ce qui est parfois « mission impossible » ! Ça demande beaucoup de créativité, mais sur des sujets différents, trouver des noms de trophées rigolos, des noms d’armes qui en jettent, etc. Quand je traduis du jeu vidéo, j’essaye de me projeter en tant que gameuse. Il faut prendre en compte le côté ludique et facile à comprendre. Autre difficulté, on a souvent très peu de contexte ! Quasiment pas d’image, à part un accès au jeu s’il est déjà sorti. Mais bon, on n’a pas le temps de platiner le jeu pour être sûr de comprendre de quoi tel ou tel personnage parle dans la mission cachée tout à la fin du mode histoire… Pour le manga, en revanche, on a tout sous les yeux (sauf quand l’auteur fait une référence ultra ambiguë à une situation qu’il prévoit de dessiner dans un futur volume… Ça arrive…) et on produit un texte qui va être lu au sein d’une planche. Jouer et lire, ce sont des façons très différentes d’appréhender le texte.
Claire je lis que tu es traductrice technique spécialisée, qu’est-ce que ça signifie par rapport à une traductrice classique (si ça existe un traducteur « classique ») ?
C : La traduction technique, c’est par exemple la traduction de brochures, de communiqués de presse, de sites web, de modes d’emploi, etc. Je me suis spécialisée dans les domaines de la mode, des cosmétiques et du tourisme. Par rapport à la traduction littéraire (on dit « littéraire » plutôt que « classique »), je ne suis pas payée en droits d’auteur, mais j’édite des factures en tant qu’autoentrepreneur.
Comme c’est très difficile de vivre uniquement de la traduction de manga, cette seconde activité (qui est, au final, ma principale) m’est indispensable.
La bonne traduction…
Question classique, mais vous n’avez pas forcément la même réponse toutes les deux : une bonne traduction, c’est quoi selon-vous ?
C : Nous avons quasiment le même avis sur le sujet. Selon nous, une bonne traduction est celle dont le résultat est naturel en français, celle qui fait oublier que l’œuvre est écrite dans une autre langue à la base. Pour cela, il ne faut pas hésiter à s’écarter de la structure des phrases originales, ne pas hésiter à prendre quelques libertés, utiliser des expressions bien françaises. Il faut aussi garder en tête qu’il n’y a jamais qu’une seule solution, qu’une seule bonne traduction. Pour le même texte, il peut y avoir plein de « bonnes traductions » différentes, qui correspondent à des choix différents. La traduction, c’est avant tout une question de choix. C’est pour ça que c’est subjectif. Certains trouveront tel ou tel choix bon ou mauvais et d’autres penseront tout l’inverse. Et c’est tout le dilemme, parfois, parce que faire un choix, c’est renoncer à un autre.
En même temps, nous pensons qu’il ne faut pas tout adapter, car le manga est, selon nous, un moyen de découvrir une autre culture.
Autre question classique justement, et souvent sujet à débat : les références culturels ou les gags… On les garde tel quel et on annote… ou on adapte ?
C : Cela dépend des cas. En général, nous pensons qu’il vaut mieux essayer d’adapter les gags, surtout s’ils sont au cœur du récit, comme dans un manga humoristique où il y en aurait beaucoup. S’il fallait lire une note à chaque page, la lecture serait moins agréable et on finirait par perdre le fil de l’histoire. Par contre, pour ce qui est des références culturelles, nous sommes plus pour les laisser telles quelles, parce que, comme nous le disions dans la question précédente, le manga permet de découvrir une culture étrangère, de s’y plonger.
Mais bien sûr, cela se décide au cas par cas. L’idée, c’est que la lecture soit le plus fluide possible, donc si on peut trouver une référence française qui colle parfaitement au contexte, on l’utilise. Sinon, on met une note, mais la plus concise possible.
Des fois, il y a aussi la possibilité d’expliciter au sein du texte même. Par exemple, si on a dans une phrase le nom d’un magazine qui s’appelle, mettons le « Super Dragon », et qui est très connu au Japon, mais totalement inconnu des lecteurs français. Une solution est alors de traduire par « Tu lis le mensuel Super Dragon, toi ? » En rajoutant juste « mensuel », on s’évite une note et tout le monde a compris de quoi on parlait.
Qu’est-ce qui est le plus dur dans votre métier et, au contraire ou pas, qu’est-ce que vous préférez ?
C : Le plus dur dans la traduction du japonais, c’est le fait que c’est une langue à contexte, comme il l’a été évoqué plus haut. On se demande souvent : « Mais, qui est le sujet de cette action ? », « Qui fait quoi, là ? » Et quand on a la tête collée à notre traduction, on peut avoir du mal à s’en sortir. C’est pourquoi nous avons de la chance de pouvoir nous entraider. Souvent un regard extérieur neuf permet de débloquer l’affaire.
Sinon pour ce qui est du métier de traducteur de manga, en général, le plus dur, c’est qu’il est très difficile de ne vivre que de ça. Par exemple, par rapport à la traduction technique, le manga est moins rentable. Le rapport effort/rémunération est beaucoup moins intéressant.
Par contre, nous avons la chance de travailler dans un domaine que nous aimons depuis des années, de découvrir de nouveaux titres, etc.
A : D’autre part, parfois le plus dur, c’est justement que c’est du travail. Difficile, le soir, d’ouvrir un manga innocemment sans penser au boulot. De ne pas se dire : « ah, tiens, pourquoi il a fait ça, là ? », ou encore : « oh, c’est une super trouvaille, ça, faut que je m’en souvienne ! » On a du mal à redevenir de simples lecteurs. C’est pareil en japonais, on se demande ce qu’on ferait, on se surprend à réfléchir pendant 5 minutes à la bonne traduction pour un jeu de mots au lieu de lire tranquillement.
Et puis, on se rappelle qu’on serait un peu gonflé de se plaindre. Qu’on a une chance formidable de jongler entre tous ces univers différents, de donner notre voix à des personnages et des scénarios géniaux.
Avez-vous une anecdote ou un traduction marquante lors de l’une de vos traductions ?
 C : L’histoire des jeux de mots de la question précédente m’a rappelé un brainstorming que nous avons eu avec Anaïs et Martin (lettreur au BS) pour Akatsuki. Je cherchais comment traduire « akagiri », la technique qui consiste à tuer les akatsuki et à les enfermer dans une fiole, et je leur ai demandé leur aide. En japonais, « akagiri » est composé de « aka » pour « akatsuki » et « giri » dérivé de « kiru » qui veut dire « pourfendre ». Il fallait que le mot sonne « médical » pour coller à l’univers du manga. Nous avons alors fait la liste de tous les mots médicaux qui nous passaient par la tête : chirurgie, opération, traitement… puis j’ai pensé à « dissection », ce qui collait le plus à l’idée de « kiru » : « pourfendre, couper ». Et c’est alors que Martin a eu un éclair de génie en lançant : « aka-section » ! Un vrai travail d’équipe : c’est ça qui me plaît dans le fait d’être regroupé en « studio ».
C : L’histoire des jeux de mots de la question précédente m’a rappelé un brainstorming que nous avons eu avec Anaïs et Martin (lettreur au BS) pour Akatsuki. Je cherchais comment traduire « akagiri », la technique qui consiste à tuer les akatsuki et à les enfermer dans une fiole, et je leur ai demandé leur aide. En japonais, « akagiri » est composé de « aka » pour « akatsuki » et « giri » dérivé de « kiru » qui veut dire « pourfendre ». Il fallait que le mot sonne « médical » pour coller à l’univers du manga. Nous avons alors fait la liste de tous les mots médicaux qui nous passaient par la tête : chirurgie, opération, traitement… puis j’ai pensé à « dissection », ce qui collait le plus à l’idée de « kiru » : « pourfendre, couper ». Et c’est alors que Martin a eu un éclair de génie en lançant : « aka-section » ! Un vrai travail d’équipe : c’est ça qui me plaît dans le fait d’être regroupé en « studio ».
A : Pour ceux qui sont friands d’anecdotes de traduction, je recommande vivement de suivre notre compte Twitter @blackstudioFR. À chaque sortie de volume, on donne une petite anecdote reliée à notre boulot ou sur les difficultés rencontrées dans le tome. Du coup, je vais plutôt parler d’une situation annexe. On a assisté l’année dernière à une conférence à la Maison du Japon sur la traduction de mangas. Elle était animée par Patrick Honnoré, dont j’admire beaucoup le travail. Il y était question, notamment, des différences culturelles entre le Japon et la France, et tout à coup, je vois apparaître une page de Paris, le retour, le volume 2 de J.P. Nishi, projetée en gros plan pour illustrer le propos. Ils ont échangé sur cet exemple en commentant ce qu’il y avait d’intéressant au niveau de la traduction. Personne ne savait que j’étais dans la salle et je dois avouer que ça m’a fait drôle d’être tout à coup citée en exemple devant tout ce monde. J’étais très gênée, je me suis faite toute petite dans mon siège.
Black Studio : une équipe autour du manga
Finissons avec Black Studio, quand est-ce que le studio est né, quel est le concept ?
A : Le Black Studio est né d’une discussion entre les fondateurs, Martin et moi. Lui était en plein début de carrière de graphiste et venait de découvrir le métier de lettreur, alors que moi, je jonglais encore entre les métiers de prof de FLE et de traductrice. On s’est dit « Tiens, et si on bossait ensemble ? », mais ça restait très vague. C’est en revenant du Japon qu’on s’est vraiment lancés. Là-bas, on y avait rencontré Claire qui est vite devenue une amie proche. Comme nous savions qu’elle souhaitait travailler en tant que traductrice, nous lui avons proposé de nous rejoindre.
Le concept était simple, on s’était aperçu qu’en travaillant côte à côte, traducteur et lettreur, on améliorait le travail de l’autre naturellement. Martin pouvait m’apporter du recul sur sa lecture de l’image, tandis qu’on pouvait peaufiner ensemble le sens et le graphisme d’une onomatopée. En découvrant le milieu, c’est devenu évident ; en général, il y a très peu d’échanges entre les traducteurs et les lettreurs. Ils travaillent chacun de leur côté, le tout étant géré par l’éditeur. Travailler directement entre personnes qui se font confiance, c’est du gain de temps et de qualité pour tout le monde. L’éditeur y est gagnant et le lecteur aussi.
Black Studio est une société regroupant des traducteurs mais aussi des adaptateurs et des lettreurs… Tous nos lecteurs voient assez bien ce qu’est un traducteur mais qu’en est-il des deux autres métiers, quel est leur rôle ?
C : Le lettreur, c’est le graphiste qui retouche les images pour retirer les textes japonais, qui crée les onomatopées et qui dispose le texte du traducteur dans les bulles. C’est un métier de création encore moins reconnu que celui de traducteur. Pourtant, certains font un travail exceptionnel d’adaptation graphique pour que lecteur français ressente la même chose que le lecteur japonais.
L’adaptateur, tel qu’on le propose, c’est une tierce personne qui a une connaissance pointue de la grammaire et de l’orthographe, mais aussi un talent pour l’écriture, et qui va relire le texte du traducteur (avant ou après lettrage) pour signaler des corrections. C’est un acteur essentiel pour la qualité d’une œuvre, car il tient le rôle du second regard, détaché, qui sera de bon conseil pour améliorer le texte. Nous assurons ce rôle l’une pour l’autre (ou pour un traducteur externe) lors qu’un éditeur commande une relecture.
Vous travaillez avec plusieurs éditeurs, est-ce les demandes changent d’un éditeur à l’autre, quelles sont-elles en général ?
C : Chaque éditeur a son fonctionnement interne, sa politique éditoriale et ses habitudes. Nous nous y adaptons, car c’est la base de notre métier de prestataire. Il peut nous être confié juste la traduction, juste le lettrage ou les deux ensemble. Plus en détail, un éditeur aura son propre système d’indexation du manga et de légendes à respecter sous Word, par exemple. De leur côté, les lettreurs ont aussi des nomenclatures différentes à respecter.
Nous travaillons aussi pour Delitoon, qui fait du webtoon, de la BD coréenne presque exclusivement numérique. Comme nous ne parlons pas coréen, nous nous occupons uniquement de la relecture et endossons le rôle de l’adaptateur pour corriger les fautes grammaticales et orthographiques. Martin et Catherine (la seconde lettreuse) effectuent les lettrages à partir de nos fichiers et leur travail est complètement différent de celui effectué sur un manga.
Black Studio a été créé en 2010. Vous êtes arrivés sur Twitter il y a un peu plus d’un an en octobre 2015 et vous comptez plus de 1800 tweets à votre actif. D’où vient cette envie de communiquer avec les lecteurs et quel en est le but pour Black Studio ?
A : Au début de notre activité de studio, nous avions créé une page Facebook pour parler de nous et de nos métiers méconnus. Mais, cantonnée au cadre amical-familial, la page n’a jamais décollé et nous l’avons un peu délaissée. C’est Martin, zonant anonymement sur Twitter depuis quelques années, qui a proposé l’idée, alors qu’il suivait déjà plusieurs éditeurs et personnalités du « Game Manga », de monter le compte Twitter du Black Studio pour parler facilement à tous ceux que ça intéresse. C’est moi qui ai enchaîné sur l’idée des anecdotes dont je vous ai déjà parlé plus haut. C’est assez unique et je crois que nous sommes les seuls à proposer cette formule sur le réseau. Depuis septembre, on réanime notre page Facebook (@blackstudioFR) et on relaie les anecdotes dessus ! Avis aux amateurs !
Nous avons toujours eu envie de communiquer sur nos métiers, car ils sont peu connus. Pendant longtemps, quand on parlait d’une traduction, c’était pour dire qu’elle était mauvaise, presque jamais dans l’autre sens. La plupart du temps, le traducteur n’était même pas cité, d’ailleurs. Depuis quelque temps, ça bouge un peu et c’est important pour nous de participer à ce cercle vertueux. Souligner ce qui est bien, ce qui est mieux, plutôt que l’inverse. Et aussi échanger avec d’autres traducteurs, lettreurs ou éditeurs, apprendre les uns des autres. Dans le fond, c’est un peu la même logique que celle qui nous a poussés à nous réunir en studio. C’est toujours facile de critiquer un choix de traduction, mais ne serait-ce pas plus intéressant de découvrir le cheminement de ce choix ? Les traducteurs ont un statut d’auteur, et communiquer sur cet aspect du travail participe à la défense du métier, qui est trop souvent maltraité.
Dernière question : quel est le titre que vous aimeriez ou vous auriez aimé traduire (et pourquoi) ?
C : Le titre que j’aurais aimé traduire, si j’étais née beaucoup plus tôt, aurait été Ranma. J’étais une grande fan de cette série, j’ai vu tous les animés, OAV, films, etc. C’est une série qui m’a marquée. Sinon, j’aurais bien bossé sur Samurai Deeper Kyo... officiellement !
A : Question très difficile, ce qu’on aime lire n’est pas forcément ce qu’on aimerait traduire. Hé hé, parce qu’il y a certains titres dont on sait qu’ils sont un enfer pour le traducteur. Mais il me vient en tête deux titres. Une série de 4 volumes qui n’a pas encore trouvé son éditeur en France et qui s’appelle Saltiness de Minoru FURUYA. C’est un seinen déjanté avec des marginaux complets pour héros. Et je pense aussi à une autre série, parue en France cette fois, mais qui m’a transportée récemment : Lorsque nous vivions ensemble de Kazuo KAMIMURA. Sublime, cruel, dérangeant et poétique.
Merci pour votre temps Anaïs et Claire, et longue vie à BLACK Studios !
Suivez le travail de BLACK Studio via leur site internet ou sur les réseaux sociaux, Twitter ou Facebook.




















2 réponses
[…] Lien : Journal du Japon […]
[…] désirez en apprendre plus sur Claire Olivier, rendez-vous ici et lisez l’interview qu’elle a donné pour Journal du Japon en 2017 […]