[Master Class] Le manga, de l’impression à la mise en rayon
Lorsque les lecteurs rencontrent un mangaka ou un éditeur, une question revient souvent : comment fait-on un manga ? Là où la plupart des intervenants parlent de l’écriture du storyboard, de la relation entre l’auteur et son tantô et de la répartition des cases dans une page, Karim Talbi, directeur de production et fondateur d’Isan Manga, et Erick Piton, imprimeur dans la SCOP Laballery, ont pris le parti de développer un aspect auquel le consommateur ne pense pas forcément : la fabrication du livre en lui-même.
Ces deux experts ont su démontrer que ce sujet peut être plus passionnant qu’il n’y paraît, puisqu’ils ont su captiver une salle plus que comble pendant plus d’une heure. Pédagogues et accessibles, ils ont su répondre à toutes les questions avec beaucoup de pertinence.
Le point de départ : La sélection du titre
Karim Talbi : Très brièvement, puisque ce n’est pas vraiment le sujet. Pour commencer, il faut savoir qu’Isan signifie patrimoine en japonais. Du coup, on ne publie que des titres qui ont un certain âge, type vintage. On choisit donc le titre par rapport à ça, que ça concerne de près ou de loin de patrimoine japonais, que ce soit des titres comme la nouvelle île au trésor, qui date de 1947, ou Le disciple de Doraku, qui touche plus au patrimoine culturel en parlant de Rakugo et de tradition japonaise, ou simplement des titres cultes, comme Judo Boy.
On va commencer par lire plein de choses, parce choisir un titre, ça ne se fait pas par magie. C’est vrai qu’on triche un peu puisque les titres vintage, on les a déjà lus. On avait un peu de marge dans notre sélection. Ensuite, c’est l’acquisition des droits. On va démarcher des éditeurs et des auteurs japonais en leur disant qu’on souhaite publier ce livre, et c’est là qu’arrivent les complications.
Nous avons décidé de faire un genre de livre bien particulier et il faut expliquer à l’éditeur japonais qu’on va faire un livre « mais pas comme les autres, pas comme vous, pas comme personne : quelque chose de nouveau. » Ça a été difficile et un peu long, parce qu’il a fallu faire comprendre qu’on voulait faire des livres très haut de gamme, une sorte d’édition « deluxe » sans faire de tirage « normaux » à coté. Ça a été un peu particulier, il a fallu qu’on fabrique des maquettes de livre pour expliquer ce qu’on va faire concrètement. C’est assez bizarre de se dire « bon bah voilà, on va contacter un imprimeur et lui demander de nous produire un livre blanc, sans rien dessus, mais qui montre quand même la reliure, etc. » L’étape de traduction et de maquette est assez standard, mais il fallait montrer pourquoi on a choisi de publier un ouvrage de cette qualité, avec une dorure, un argenté, un vernis sélectif…
Des délais en tous genre…
K.T. : L’achat de droits, pour commencer. Les négociations sont assez longues, pour trouver un accord avec l’éditeur japonais. Je ne fais pas de nouveauté, je n’ai pas de livres sortis il y a deux mois au Japon dans mon catalogue, mais la traduction et la relecture sont chronophages. Pour avoir une traduction de qualité, il faut du temps. Bon, je peux demander au traducteur de le faire en deux jours, il ne dormira pas beaucoup et il y aura pas mal d’erreurs. En général, un traducteur met trois semaines pour traduire un livre. Sur un volume double de 400 pages, vous multipliez ce délai par deux.
Il y a aussi la maquette. Le fichier japonais, c’est bien, mais il faut mettre le texte dans les bulles, qu’on retouche les onomatopées pour qu’elles soient en français, etc. Selon le type de livre, ça peut prendre de 10 à 15 jours.
Enfin, tout le processus de fabrication, quand j’envoie un livre chez mon imprimeur, je sais que je vais être livré au mois suivant. En urgence, on peut aller beaucoup plus vite : je pense qu’en 10 jours c’est encore jouable.
E.P. : Cinq jours, voire trois s’il y a vraiment urgence et si le tirage n’est pas trop important, mais ça dépend des imprimeurs et de leur organisation. Il faut savoir que ce sont des machines qui tournent en quatre huit, chez nous, et un livre en pousse un autre. On a ce qu’on appelle la charge de travail et si Karim me dit « écoute, tu te débrouilles, il me faut un livre dans une semaine », on regarde la charge de travail, le nombre de livres qu’on doit imprimer, et si ce nombre est trop important, on va lui dire qu’il nous faut plus de temps. Il peut alors décider d’aller chez un autre imprimeur qui est moins chargé. Pour 3000 exemplaires, s’il n’y a pas de placards, pas trop d’encre sur le papier et donc un temps de sèche moins long, il faut compter grosso modo 15 jours.
K.T. : Pour nous, il y a des dorures, des marquages à chaud, des vernis sélectifs. L’imprimeur n’a pas forcément la machine qui permet de le faire, donc il devra le sous-traiter à un de ses collègues, ce qui rallonge l’impression de quelques jours.
Du choix du papier au vernis sélectifs, ces détails qui font la différence
Erick Piton : Peu de gens le savent, mais faire une bande dessinée est plus compliqué que de faire un beau livre d’images en quadrichromie. On va contacter l’éditeur, ou l’inverse, et il va demander un devis autour duquel va s’installer une réflexion. Il va par exemple demander « est-ce que je peux prendre un papier de 70g ? », comme on en trouve dans des collections comme La Pléiade. Non, c’est trop transparent car quel que soit le procédé, en offset comme en jet d’encre, on risque de traverser le papier. La conséquence pour le lecteur, c’est qu’en ouvrant le livre, vous allez lire à la fois l’endroit et l’envers en même temps.
Donc on doit expliquer à l’éditeur qu’un papier de 70g n’est pas suffisant et l’orienter vers quelque chose de convenable. Le standard commencera avec des papiers de 80g, sur lequel ça se tiendra beaucoup mieux, ça ne traversera pas. Je conseillerai donc à l’éditeur de prendre du papier de 80g, voir 90g. Le grammage définit la dureté du papier sous le doigt. Par exemple, du carton va faire 300-400g alors que le papier format A4 de bureau fait en général 80g. Mais même en 80g, il faut faire attention aux placards, les pages toutes noires comme chez Ki-oon, car le problème risque de persister. Le choix du papier est donc très important, mais celui de sa couleur l’est tout autant.
Il y a énormément de fabricants de papiers en Europe, surtout dans le nord, où ils gèrent très bien leurs forêts, mais le papetier a un panel de papiers absolument incroyable. Dans les 80g, il y en a de toutes les couleurs, et certains ont même des mains. Il s’agit de la sensation du papier qui paraît beaucoup moins souple et de meilleure qualité. Ce sont des subtilités qu’un éditeur ne va pas forcément connaître et on se doit de le conseiller. Isan Manga utilise par exemple du Ensolux Cream 80g, avec une main de 1,8. Tous les modèles de papiers ont un nom, et il doit exister environs 5 à 6 000 sortes de papiers sur le marché.
Une impression de stress
K.T. : C’est alors que va arriver « la période du stress ». On envoie nos fichiers à l’imprimeur, en sachant qu’ils sont bons, parce que mon bureau de fabrication (donc moi) a mis ses fichiers à la bonne résolution, les trames sont bien traitées comme il faut. L’imprimeur nous renvoie un bon à tirer, numérique ou papier, pour vérifier que les pages sont dans le bon sens, que tout se passe bien. Une fois tout le monde d’accord, on va lancer l’impression.
E.P. : Les fichiers qui sont validés sont au format PDF. Cela permet de bien caler les choses et de renvoyer une preuve qu’on a bien reçu le fichier par internet. L’éditeur va ensuite le valider et à partir de ce moment, le stress, c’est nous. Pour commencer, on va vérifier les fichiers, pour voir si la trame est bonne, si les fichiers ne sont pas corrompus. Il existe une particularité japonaise assez unique qui fait qu’on a des problèmes pour convertir les fichiers provenant du Japon qui arrivent sur nos ordinateurs.
On a des surprises, comme des effets de « moirage », par exemple. C’est comme si vous aviez des vagues qui n’ont rien à faire là dedans. Si Jamais Karim reçoit ça, je vais me faire jeter et il va encore me demander 20% ! (Rires) A ce moment, nous avons des fabricants qui vont appeler Karim pour lui dire « écoutez, votre fichier, si on l’imprime comme ça, ça va faire un truc complètement pourri et vous ne serez pas content. » Et en plus, vous, en tant que lecteurs, vous allez dire « quand même, ils auraient pu faire un effort sur la qualité ! »
Le fichier revient donc chez l’éditeur qui va essayer de transformer les fichiers autrement. Nous sommes désormais capables de le faire nous-mêmes, nous avons cette expérience du manga, donc on va s’occuper de cette modification.
Quelqu’un dans l’assistance : Quand vous parlez des imperfections, vous dites qu’il y en a toujours, mais que l’éditeur peut faire pression quand c’est important, pourtant ça existe des manga où la page est trop courte ou alors il manque la dernière lettre d’une bulle, ou au contraire, pour le lire, il faut écarteler le livre…
K.T. : C’est pas chez nous ! (Rires) Non, ça arrive à tout le monde, maintenant, il faut comprendre que quand on est éditeur et qu’on reçoit dix mille livres, on ne vas pas tous les ouvrir. Après, c’est une affaire de fichier. Il faut savoir qu’on a une marge, d’en général 5 millimètres de chaque coté, et on sait que la page peut bouger. Il suffit que la case soit proche d’une marge et que la page bouge pour qu’on coupe du texte. Il faut surtout faire attention au début à avoir ces marges à l’étape de la maquette, sans texte, sans rien.
Pour le manga, on ne choisit pas, c’est dessiné comme ça. On ne peut pas dire « ah, je vais bouger la bulle ». On n’a pas le droit. Donc c’est un peu compliqué, mais en amont, il faut savoir le traiter. Mais ce sont des choses qui arrive. Par exemple, pour nous, on n’a qu’un format de livre, en 15cm x 25cm. Au Japon, les manga ont des formats différents selon les éditeurs. Pour que tout rentre dans le livre, il faut modifier la taille des planches de façon proportionnelle, ce qui peut manger sur cette marge de sécurité. C’est un risque. Dans notre cas, on doit généralement agrandir les planches, donc le risque reste très modéré. Dans le cas inverse, c’est plus compliqué. Mais quand ça arrive, c’est souvent des erreurs à la maquette.
Au Japon, la fabrication du livre n’a pas lieu chez l’éditeur. C’est l’imprimeur qui va directement traiter ses fichiers. L’éditeur donne ses fichiers bruts, donc l’imprimeur va donc commencer par retraiter ses fichiers. Après, ça dépend des livres. Chez moi, j’ai très peu de livres dont j’ai les fichiers PDF. Ce sont des films que je dois scanner, ou le manga japonais. Je retraite le fichier moi-même pour qu’il soit correct à l’impression.
Par exemple, Le disciple de Doraku, j’ai les fichiers, avec les trames de l’auteur qui ne correspondent pas forcément aux trames qu’on va utiliser en France. Et là, c’est le drame. Qu’est-ce que je fais ? Je vais voir un photograveur (un « imprimeur de poche » pour ainsi dire), et lui demander de me tirer un exemplaire d’une page comme si c’était fait par une machine, pour voir si j’ai du moirage ou d’autres effets indésirables.
Ce qu’il faut comprendre sur le moirage, c’est que quand on parle de livre « Noir et Blanc », il n’y a vraiment que ça. Il n’y a pas de gris. On l’obtient avec des petits points noirs espacés. Plus c’est espacé, plus le noir sera clair, vu que c’est vraiment tout petit. Dans un fichier qu’on va avoir, les trames seront déjà posées. Si l’imprimeur n’utilise pas les même, c’est la superposition de ces deux trames qui entraîne un effet d’optique de vagues, de quadrillage. En tant qu’éditeur de manga haut de gamme, le moirage, c’est ma grosse hantise. C’est la pire chose qui puisse arriver parce qu’au moment où ça arrive chez l’imprimeur, c’est pas de sa faute, c’est la mienne. C’est à moi de vérifier mes fichiers.
Pour nos deux premiers titres, on a fait sortir l’ensemble de nos cahiers par un photograveur. Ça coûtait un peu cher, mais au moins, on était sûr que l’ensemble de nos fichiers soient bons. Nos réglages étaient bons. Maintenant, on utilise les mêmes partout donc il n’y a pas de problème, on le sait.
E.P. : On va ensuite faire de l’imposition. Toutes les pages d’un manga vont être imprimées sur une énorme feuille. Cette feuille va ensuite être pliée et on va imposer les différentes pages sur la feuille. La page 1 sera en haut à gauche, la page 2 sera perdue quelque part dans la feuille, la page 3 sera au verso, etc. Lorsque c’est imprimé recto-verso, on va avoir une période de séchage après l’impression en offset. Ce sont de grosses machines qui impriment assez vite, on arrive à un rendement de 15 000 feuilles par heure. Ces 15 000 feuilles ne vont rassembler qu’un seul cahier. Pour faire un manga de 92 pages, suivant le format, il va falloir faire 10 cahiers. Donc on imprimera 15 000 feuilles fois 10.
Une fois séchées, ces feuilles vont dans des machines appelées « plieuses ». On va plier la feuille, avec toutes les pages qui vont se retrouver dans l’ordre. Ce sont des machines toutes bêtes, qui vont prendre la feuille, la plier X fois, pour un rendement d’environs 20 000 feuilles par heure, et c’est extrêmement bruyant ! On obtiendra donc un premier cahier plié, puis on pliera tous les autres cahiers. On va ensuite serrer ces cahiers très fort pour éviter que le livre ne s’ouvre lorsque vous l’achetez. Si on n’applique pas une pression de l’ordre de 5 bars pendant 24 heures, il serait impossible de le fermer. On va ensuite rassembler 10 cahiers différents et on va les assembler sur la carte, qu’on a imprimé auparavant, avec de la colle, tout simplement.
Une fois assemblé, le livre doit être coupé pour enlever les pliages et rendre l’ouvrage lisible. Il est donc un peu plus haut, un peu plus large. Trois lames vont couper en haut, en bas et devant. C’est là que se dessine toute la magie de l’impression, parce que c’est à ce moment précis que le papier devient un livre. Il arrive parfois qu’un cahier soit inversé, que le cahier numéro 1 se retrouve au milieu du livre, par exemple. On est alors obligés de tout refaire et on ressert l’éditeur. Cela coûte cher, c’est sûr, mais on préfère perdre de l’argent plutôt que de perdre un client.
Nous avons une autre contrainte : on a des obligations vis à vis d’un distributeur. C’est une société qui va livrer les libraires. Le problème, c’est que c’est très strict : ils ne peuvent recevoir les livres que deux fois par semaine à certaines heures. Si on rate la première fois, ça peut aller pour ce qu’on appelle le deuxième office, mais si on le rate aussi, on ne peut pas livrer. Les portes se ferment, puisque le distributeur doit gérer des flux de livres assez monstrueux. Interforum gère au bas mots 10 000 titres dans de gigantesques hangars.
De la distribution des rôles à la répartition des gains
K.T. : Chez Isan Manga, on travaille chez un petit distributeur-diffuseur, Makassar. Il va recevoir sa palette de manga, le jour J à une heure H. Son équipe commerciale d’une quinzaine de personnes passe leur journée au téléphone ou en voiture pour démarcher toutes les librairies de France. Vous vous imaginez bien que ça ne part pas par la poste, et que les commerciaux ne vont pas s’amuser à les livrer eux-mêmes. Il passe par une chaîne qui s’appelle Prisme qui reçoit tous les livres de tous les éditeurs qui passent par ce système (ce qui exclut la Fnac et Amazon, qui ont la leur). Ces gens là vont stocker tous les cartons avec les livres d’Isan Manga, de Ki-oon, etc. Cela fait donc plusieurs plusieurs étapes pour arriver chez le libraire. Il y a au moins trois entreprises qui reçoivent les livres, et tout ça, ça a un coût.
Prenons un exemple simple, avec un manga qui coûterait 10€. Il faut savoir que lorsque le libraire commande un livre, qu’il soit vendu ou non, ça ne change pas grand chose. Il achète son livre, le paye au distributeur, et s’il ne le vend pas, il le rend au distributeur qui le rembourse. Donc l’éditeur rembourse le distributeur. C’est compliqué à gérer pour un libraire, parce que c’est de la trésorerie qui sort, ça met du temps, donc c’est très difficile de trouver un équilibre.
De son côté, le distributeur va lui aussi prendre sa marge, le libraire prend sa marge, l’intermédiaire aussi. On a payé l’imprimeur, un maquettiste, la communication qui va autour, donc à la fin, il reste un euro pour l’éditeur. Si le livre ne se vend pas, il faut rembourser, donc on perd de l’argent, forcément. C’est le rôle de l’éditeur de choisir des titres qu’il estime vendables. Donc on a toute une réflexion pour arriver à un seuil de rentabilité. On calcule tous nos coûts, et on estime le nombre qu’on doit réussir à vendre pour pouvoir rentrer dans nos frais par rapport au nombre de volumes tirés. Ce n’est rien de très sorcier, mais il faut savoir le faire.
En tant qu’éditeur, on ne sait pas vraiment quand les ouvrages sont vendus. On sait quand ils sont placés en magasin, mais ils peuvent nous revenir à tout moment. Quatre ans après, le libraire peut dire « bah tiens, ça je l’ai pas vendu, je le renvoie » et on le rembourse. C’est la toute la complexité du métier d’éditeur : on parie sur des titres.
Quelqu’un dans l’assistance : Qu’est-ce qui se passe si une série n’a pas marché pendant un an, puis d’un coup, avec un coup de marketing ou autre, devient populaire ?
K.T. : Pour l’instant, ça ne nous est pas encore arrivé! (Rires) Si ça arrive, je rappelle Erick et je lui dis « hé, on recommence ?! » Et là, en plus, il peut faire de petits tirages !
 E.P. : C’est Jacques Glénat qui a imposé la façon de lire à la japonaise et c’est toujours un grand éditeur. Il y a eu des bonds de progression de 30-35% par an, des tirages à deux cents, trois cents milles exemplaires, des choses incroyables. De nos jours, la tendance est plutôt à la baisse et donc à la baisse des tirages. On en arrive parfois à faire des tirages à… trois cents exemplaires ? Pourquoi ? Parce que si j’ai bien compris, les japonais veulent que pour une série de 72 tomes, tous les titres, même ceux qui ne fonctionnent pas, soient tous présents sur le marché.
E.P. : C’est Jacques Glénat qui a imposé la façon de lire à la japonaise et c’est toujours un grand éditeur. Il y a eu des bonds de progression de 30-35% par an, des tirages à deux cents, trois cents milles exemplaires, des choses incroyables. De nos jours, la tendance est plutôt à la baisse et donc à la baisse des tirages. On en arrive parfois à faire des tirages à… trois cents exemplaires ? Pourquoi ? Parce que si j’ai bien compris, les japonais veulent que pour une série de 72 tomes, tous les titres, même ceux qui ne fonctionnent pas, soient tous présents sur le marché.
Imaginons le scénario suivant : vous faites 3 000 exemplaires, vous les vendez, ça a super bien marché. Vous faites une réimpression de 3 000 tomes, et c’est un four : ça ne marche pas. Les libraires renvoient les volumes, et il y a un taux de retour de 90%. Cela pose un problème de stockage, et l’éditeur a avancé l’argent de la réédition. C’est énormément de risques. Donc plutôt que de faire ça, il va venir me voir et demander « est-ce que tu es capable d’imprimer un tome à 300 exemplaires ? »
Les manga qu’on trouve habituellement dans le commerce sont imprimés avec la technique Offset que l’ont a décrite précédemment. C’est une méthode qui date des années 20, 30, un peu coûteuse mais qui se rentabilise par un tirage élevé. Les minima étaient autrefois de 1000 exemplaires. Il a donc fallu trouver une autre méthode : le jet d’encre. Nous sommes les seuls en France capables d’imprimer en full numérique, full jet d’encre. Il n’y a quasiment aucune différence pour le lecteur. En revanche, l’éditeur va voir que c’est petit peu plus pâle. Et ça ne convient pas aux placards, ces pages noires utilisées pour introduire un nouveau chapitre. Cela permet de répondre à la problématique de l’édition qui perd beaucoup de sous et qui prend énormément de risques.
E.P. : Pour revenir sur nos 10€, détaillons un peu la répartition :
– Pour l’imprimeur, de 30 centimes à 1 euro selon le tirage.
– 1 euro pour l’éditeur quand le livre se vend
– 1 euro pour l’ayant-droit
– 5 à 6 euros pour le distributeur. Il ne faut pas oublier qu’il a toute une équipe qui passe son temps au téléphone à démarcher les libraires, qu’il stocke, qu’il prête les retours. Cela comprend aussi la marge du libraire, qui va garder 3 à 4 euros, vu qu’il est le vendeur final.
– Les 1 à 2,70 euros qui restent servent au marketing
K.T. : Bien sûr, ces valeurs sont approximatives, et surtout, hors taxes. A noter que les ouvrages que nous publions chez Isan Manga sont bien plus coûteux à imprimer : il faut compter à peu près 4,5 euros par volume, mais ce n’est pas la même échelle, étant donné que nos volumes sont vendus 29,90 euros pièce.
Du coup, tout le monde prend sa part et gagne peu d’argent, mais rentabilise ce marché sur le volume. Cependant, le volume du marché diminue. Donc les revenus de tous les maillons de la chaîne se retrouvent amoindris jusqu’à atteindre des situations plutôt difficiles. Aujourd’hui, on a des éditeurs qui ont de plus en plus de mal à tenir, des libraires qui ferment boutique un peu partout mais aussi des imprimeurs qui mettent la clé sous la porte.
Quelqu’un dans l’assistance, alors que le staff de Japan Expo vient nous signaler que nous devons libérer la salle : Chez Isan Manga, comment luttez-vous contre la lecture en ligne ?
K.T. : Déjà, la lecture en ligne n’est pas forcément une mauvaise chose. Il y a des systèmes légaux de lecture en ligne. Je vois Erick tirer un peu la tête, c’est normal, parce que du coup, il n’imprime plus. Pour le scantrad, en terme de moyen, c’est surtout une augmentation de la publication légale en ligne, comme c’est le cas avec la VoD et les dessins animés, par exemple, avec le chapitre en J+1 ou J+5, ou quelque chose comme ça. Mais ne t’inquiète pas Erick, ça ne remplacera pas le livre physique !
E.P. : Il y a intérêt, sinon je m’en vais ! (Rires)
K.T. : Chez Isan Manga, de toute façon, nos titres, quand ils datent par exemple de 1947, on ne peut pas aller plus vite que le livre physique. On n’a pas ce problème dans le sens où, comme on publie des œuvres vintage, du coup, s’ils sont en ligne, ils le sont depuis belle lurette. Par contre, on lutte à notre façon, en vendant des ouvrages de bonne qualité, qui en plus d’être des livres sont des objets de collection. On propose un plus, en somme. Au delà de ça, il y aura toujours du piratage et on ne peut rien y faire. Je ne vais pas aller attaquer en justice tous les gens qui mettent un scan en ligne. Je n’ai pas le temps et ce n’est pas mon métier. Au Japon, c’est quelque chose qui revient souvent. Pour un de mes titres, par exemple, je suis engagé par contrat d’attaquer en justice si je trouve une version pirate en ligne de mon édition. Après, c’est clair qu’en tant qu’éditeur, c’est toujours vexant quand on trouve son travail scanné et mis sur internet, mais je pense que c’est inévitable…
Remerciements aux passionnants et passionnés intervenants Karim Talbi et Erick Piton, ainsi qu’à Japan Expo pour la mise en place de cette conférence.




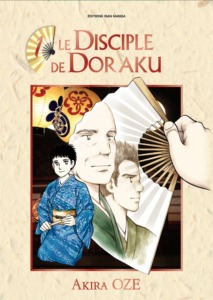















1 réponse
[…] 10 à 15% du prix d’un tome (soit environ 1€ par tome à 7€, un chiffre proche de ceux obtenus de professionnels et de recherches […]